Poésies par thèmes : la Seine, le fleuve
CYCLE 3 et COLLÈGE - LYCÉE
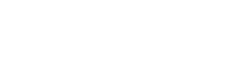
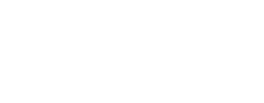
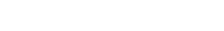
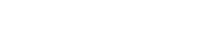
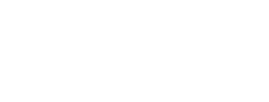
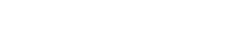
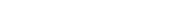
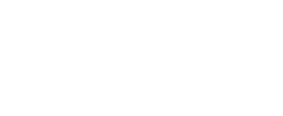
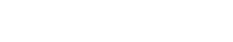
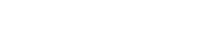
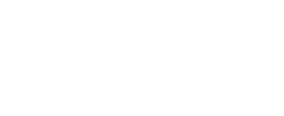
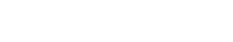
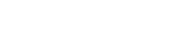
L’EAU COURANTE - LE FLEUVE - LA SEINE
textes pour LE COLLÈGE et le LYCÉE
pour le Collège, voir aussi cette page :
CHANSONS
-
1.À Paris - Francis Lemarque
-
2.La Seine - Flavien Monod
-
3.T’en souviens-tu la Seine - Anne Sylvestre
-
4.À la Seine - Jean-Roger Caussimon
-
5.L’Île Saint-Louis - Léo Ferré
-
6.Paris-blessure - Jacques Brel
-
7.J’ai le mal de Paris - Mouloudji
-
8.Poètes de la Seine - Bruno Grange
-
9.Complainte de la Seine - Maurice Magre
POÈMES SUR LA SEINE
-
10.La Seine a rencontré Paris - Jacques Prévert
-
11.Le premier frisson d'hiver - Alfred de Musset
-
12.La Seine - Louis Aragon
-
13.Paris 42 - Louis Aragon
-
14.Pour demain - Louis Aragon
-
15.Sur le Pont-Neuf j’ai rencontré - Louis Aragon
-
16.Le pont Mirabeau - Guillaume Apollinaire
-
17.Au pied des tours de Notre-Dame - Francis Carco
-
18.Paris - Jules Supervielle
-
19.La Seine était verte à ton bras ... - Michel Deguy
-
20.L’aube à l’envers - Paul Verlaine
-
21.Nocturne parisien (Toi Seine, tu n’as rien ...) - Paul Verlaine
-
22.Paris (La pente de la rêverie) - Victor Hugo
-
23.J’aime ma maison - Guy de Maupassant
-
24.Rouen - Guy de Maupassant
-
25.Devant nous la Seine - Guy de Maupassant
-
26.La Seine à Argenteuil - Guy de Maupassant
-
27.La Seine vue par un peintre - Camille Pissaro
-
28.Javert - Victor Hugo
-
29.C’est un petit village - Nicolas Boileau
-
30.La Seine de Paris - Jean Tardieu
-
31.Là-bas sur un coteau crayeux - André Druelle
-
32.Le rêve du poète - François Coppée
-
33.Valvins - Paul Valéry
On trouvera à cette adresse de nombreux tableaux d’artistes sur le thème de la Seine de Paris au Havre :
CHANSONS
1. À Paris (chanson)
À Paris
Quand un amour fleurit,
Ça fait pendant des s'main's
Deux coeurs qui se sourient,
Tout ça parce qu'ils s'aim'nt
À Paris.
Au printemps
Sur les toits, les girouett's
Tourn'nt et font les coquett's
Avec le premier vent
Qui passe indifférent,
Nonchalant,
Car le vent,
Quand il vient à Paris
N'a plus qu'un seul souci,
C'est d'aller musarder
Dans tous les beaux quartiers
De Paris
Le soleil
Qui est son vieux copain,
Est aussi de la fête
Et comm' deux collégiens
lls s'en vont en goguett'
Dans Paris.
Et la main dans la main,
Ils vont sans se frapper
Regardant en chemin,
Si Paris a changé.
Y'a toujours
Des taxis en maraud'
Qui vous chargent en fraude,
Avant le stationn'ment,
Où y'a encor' l'agent
Des taxis.
Au café
On voit n'importe qui,
Qui boit n'importe quoi,
Qui parle avec ses mains,
Et qu'est l'à depuis l' matin,
Au café
[À Paris]
Y'a la Seine,
À n'importe quelle heure
Elle a ses visiteurs
Qui la r'gard'nt dans les yeux,
Ce sont ses amoureux
À la Seine.
Et y'a ceux,
Ceux qui ont fait leur lit,
Près du lit de la Seine,
Et qui s' lav'nt à midi
Tous les jours de la s'main'
Dans la Seine.
Et les autres,
Ceux qui en ont assez,
Parc' qu'ils en ont vu d' trop
Et qui veul'nt oublier,
Alors ils s' jett'nt à l'eau,
Mais la Seine
EII' préfère
Voir les jolis bateaux
Se promener sur elle,
Et au fil de son eau,
Jouer aux caravell's,
Sur la Seine !
Les ennuis,
Y'en a pas qu'à Paris,
Y'en a dans l' monde entier,
Oui, mais dans l' monde entier,
Y'a pas partout Paris,
V'là l'ennui...
À Paris,
Au quatorze Juillet
A la lueur des lampions,
On danse sans arrêt,
Au son d' l'accordéon,
Dans les rues.
Depuis qu'à Paris, on a pris la Bastille,
Dans tous les faubourgs,
Et à chaque carr'four,
Il y a des gars, et il y a des fill's
Qui sur les pavés,
Sans arrêt, nuit et jour,
Font des tours,
Et des tours,
À Paris.
Francis Lemarque
paroles et musique de Francis Lemarque, interprétation : Yves Montand
_ _ _ _ _
2. La Seine (chanson)
La Seine est aventureuse
De Châtillon à Méry
Et son humeur voyageuse
Flâne à travers le pays
Elle se fait langoureuse
De Juvisy à Choisy
Pour aborder, l´âme heureuse
L´amoureux qu´elle a choisi !
Elle roucoule, coule, coule
Dès qu´elle entre dans Paris !
Elle s´enroule, roule, roule
Autour de ses quais fleuris!
Elle chante, chante, chante, chante
Chante le jour et la nuit
Car la Seine est une amante
Et son amant c´est Paris !
Elle traîne d´île en île
Caressant le vieux Paris
Elle ouvre ses bras dociles
Au sourire du roi Henri
Indifférente aux édiles
De la mairie de Paris
Elle court vers les idylles
Des amants des Tuileries!
Elle roucoule, coule, coule
Du Pont-Neuf jusqu´à Passy!
Elle est soûle, soûle, soûle
Au souvenir de Bercy!
Elle chante, chante, chante, chante
Chante le jour et la nuit
Si sa marche est zigzagante
C´est qu´elle est grise à Paris!
Mais la Seine est paresseuse
En passant près de Neuilly
Ah, comme elle est malheureuse
De quitter son bel ami !
Dans une étreinte amoureuse
Elle enlace encore Paris
Pour lui laisser, généreuse
Une boucle... à Saint-Denis !
Elle roucoule, coule, coule
Sa complainte dans la nuit
Elle roule, roule, roule
Vers la mer où tout finit
Elle chante, chante, chante, chante
Chante l´amour de Paris!
Car la Seine est une amante
Et Paris dort dans son lit !
Flavien Monod (chanson)
paroles de Flavien Monod et musique de Guy Lafarge,1948
interprétation : Jacqueline François (album : Mademoiselle De Paris)
_ _ _ _ _
3. T'en souviens-tu, la Seine
T'en souviens-tu, la Seine,
t'en souviens-tu comm' ça me revient,
me revient la rengaine
de quand on avait rien,
de quand on avait pour tous bagages
tes deux quais pour m'y promener,
tes deux quais pour y mieux rêver ?
Tu étais, tu étais mes voyages
et la mer, tu étais mes voiliers,
tu étais pour moi les paysages ignorés.
Je te disais, la Seine
qu'on avait les yeux d' la mêm' couleur.
Quand j'avais de la peine,
quand j'égarais mon coeur,
quand je trouvais la ville trop noire,
tu dorais des plages pour moi,
tu mettais ton manteau de soie,
et pour moi, qui ne voulais plus croire,
et pour moi, pour pas que je me noie,
tu faisais d'un chagrin un' histoire, une joie.
Ils te diront, la Seine,
que je n'ai plus de coeur à promener
ou que, si je promène,
c'est loin de ton quartier.
Ils te diront que je te délaisse
et pourtant je n'ai pas changé.
Non, je ne t'ai pas oubliée,
mon amie de toutes les tendresses.
J'ai gardé dans mes yeux tes reflets,
j'ai gardé tes couleurs, tes caresses pour rêver.
T'en souviens-tu, la Seine,
t'en souviens-tu comm' ça me revient,
me revient la rengaine
de quand on était bien?
Et si j'ai vu d'autres paysages,
tes deux quais m'ont tant fait rêver.
Attends-moi: j'y retournerai,
tu seras mon premier grand voyage.
et le port où je viens relâcher,
fatiguée de tant d'autres rivages oubliés.
T'en souviens-tu, la Seine,
t'en souviens-tu ?
Anne Sylvestre
(Paroles, musique et interprétation)
_ _ _ _ _
4. À la Seine (chanson)
Voyant tes remous, tes ressacs
Tout au long du quai rectiligne
Un moment je t'avais cru digne
De m'écouter vider mon sac
Tout comme on parle dans l'oreille
D'un chien compagnon de malheur
Quand on n'a pas assez d'oseille
Pour s'approprier la blondeur d'une fille
À la peau bien tendre
Qui fait bien semblant de comprendre
Et vous vend un peu de douceur
J'allais te confier mes alarmes
Mes fatigues et mes regrets
C'est bête à dire
J'étais prêt à te grossir
De quelques larmes
Contenues depuis trop de jours
Et d'amertumes bien salées
Mais ta flotte s'en est allée
Insensible suivant son cours
Roulant au pied de l'escalier
Tant de mètres cubes à l'heure
Tu t'en fous
Qu'on vive ou qu'on meure
T'es plus bête qu'un sablier
C'est normal
T'es un personnage
Ta place est faite au grand soleil
Les hommes et toi c'est tout pareil
Y'a pas de pitié qui surnage
T'es vaseuse dans ton tréfonds
Moi je m'en vais
Adieu la Seine
Y'a pas de pitié qui surnage
T'es vaseuse dans ton tréfonds
Moi je m'en vais
Adieu la Seine
Tu sais, avant que je revienne
De l'eau coulera sous tes ponts
Jean-Roger Caussimon
Paroles de Jean-Roger Caussimon, musique de Léo Ferré
Interprétation : Léo Ferré
_ _ _ _ _
5. L´île Saint-Louis (chanson)
L´île Saint-Louis en ayant marre
D´être à côté de la Cité
Un jour a rompu ses amarres
Elle avait soif de liberté
Avec ses joies, avec ses peines
Qui s´en allaient au fil de l´eau
On la vit descendre la Seine
Ell´ se prenait pour un bateau.
Quand on est une île
On reste tranquille
Au cœur de la ville
C´est ce que l´on dit,
Mais un jour arrive
On quitte la rive
En douce on s´esquive
Pour voir du pays.
{Refrain:}
Pour les îles sages
Point de grands voyages
Point de grands voyages
Tra la la,
Les livres d´images
Tra la la,
Se font à Paris
Tra la la la la,
Se font à Paris.
De la Mer Noire à la Mer Rouge
Des îles blanches, aux îles d´or
Vers l´horizon où rien ne bouge
Point n´a trouvé l´île au trésor,
Mais tout au bout de son voyage
Dans un endroit peu fréquenté
On lui raconta le naufrage
L´île au trésor s´était noyée.
Quand on est une île
On vogue tranquille
Trop loin de la ville
Malgré c´que l´on dit,
Mais un jour arrive
Où l´âme en dérive,
On songe à la rive
Du bon vieux Paris
{Refrain}
L´Ile Saint-Louis a de la peine
Du pôle Sud au pôle Nord
L´océan ne vaut pas la Seine
Le large ne vaut pas le port
Si l´on a trop de vague à l´âme
Mourir un peu n´est pas partir
Quand on est île à Notre-Dame
On prend le temps de réfléchir.
Quand on est une île
On reste tranquille
Au cœur de la ville
Moi je vous le dit,
Pour les îles sages
Point de grands voyages
Les livres d´images
Se font à Paris
{Refrain}
Léo Ferré et Francis Claude
Paroles de Léo Ferré et Francis Claude, musique de Léo Ferré
Interprétation : Léo Ferré
_ _ _ _ _
6. Paris-blessure
Le soleil qui se lève
Et caresse les toits
Et c’est Paris le jour
La Seine qui se promène
Et me guide du doigt
Et c’est Paris toujours
Et mon cœur qui s’arrête
Sur ton cœur qui sourit
Et c’est Paris bonjour
Et ta main dans ma main
Qui me dit déjà oui
Et c’est Paris l’amour
Le premier rendez-vous
A l’île Saint-Louis
C’est Paris qui commence
Et le premier baiser
Volé aux Tuileries
Et c’est Paris la chance
Et le premier baisé
Reçu sous un portail
Et c’est Paris romance
Et deux têtes qui se tournent
En regardant Versailles
Et c’est Paris la France
Des jours que l’on oublie
Qui oublient de nous voir
Et c’est Paris l’espoir
Des heures où nos regards
Ne sont qu’un seul regard
Et c’est Paris miroir
Rien que des nuits encore
Qui séparent nos chansons
Et c’est Paris bonsoir
Et ce jour-là enfin
Où tu ne dis plus non
Et c’est Paris ce soir
Une chambre un peu triste
Où s’arrête la ronde
Et c’est Paris nous deux
Un regard qui reçoit
La tendresse du monde
Et c’est Paris tes yeux
Ce serment que je pleure
Plutôt que ne le dis
C’est Paris si tu veux
Et savoir que demain
Sera comme aujourd’hui
C’est Paris merveilleux
Mais la fin du voyage
La fin de la chanson
C’est Paris tout gris
Dernier jour, dernière heure
Première larme aussi
Et c’est Paris la pluie
Ces jardins remontés
Qui n’ont plus leur parure
Et c’est Paris l’ennui
La gare où s’accomplit
La dernière déchirure
Et c’est Paris fini
Loin des yeux loin du cœur
Chassé du paradis
Et c’est Paris chagrin
Mais une lettre de toi
Une lettre qui dit oui
Et c’est Paris demain
Des villes et des villages
Les roues tremblent de chance
C’est Paris en chemin
Et toi qui m’attends là
Et tout qui recommence
Et c’est Paris je reviens
Jacques Brel
_ _ _ _ _
7. J’ai le mal de Paris (chanson)
J’ai le mal de Paris
De ses rues de ses boulevards
De son air triste et gris
De ses jours, de ses soirs
Et l’odeur du métro
Me revient aussitôt
Que je quitte mon Paris
Pour des pays moins gris
J’ai le mal de la Seine
Qui écoute mes peines
Et je regrette tant
Les quais doux aux amants
J’aime me promener
Dans tous les beaux quartiers
Voir au Palais-Royal
Les filles à marier
Traîner à Montparnasse
De café en café
Et monter à Belleville
Tout en haut de la ville
Pour la voir en entier
J’ai le mal de Paris
Quand je suis loin d’ici
Me prend le vague à l’âme
J’ai le cœur qui s’ennuie
Et je rêve à cette dame
Dont les toits épanouis
Autour de Notre-Dame
Font des vagues infinies
J’ai le mal de la nuit
De la nuit de Paris
Quand les filles vont et viennent
A l’heure où moi je traîne
J’ai le mal des saisons
Qui poussent leur voiture
Dans les rues de Paris
Et changent sa parure
Le printemps va gaiement
Les arbres sont contents
Puis l’été se promène
Et c’est dimanche toute la semaine
Les feuilles tombent blêmes
J’ai le mal de Paris
Durant les jours d’hiver
C’est gris et c’est désert
Plein de mélancolie
Oui j’ai le mal d’amour
Et je l’aurai toujours
C’est drôle mais c’est ainsi
J’ai le mal de Paris
Marcel Mouloudji
album : Un Gamin De Paris, 1951 paroles de Mouloudji
musique de Pierre Arimi
_ _ _ _ _
8. Poètes de la Seine (chanson)
Poètes de la Seine, auteurs de ses chansons
Qui font vibrer les coeurs et sourire la vie
Et si vous nous contiez la Seine à la façon
De tous ceux qui la servent pour la rendre jolie
Dites-vous que le fleuve n'aurait plus de bateaux
Et qu'il s'alanguirait sur de mornes rivages
Car la moitié du temps, il manquerait de l'eau
Si l'homme n'était pas bâtisseur de barrages
Poète de la Seine, il l'est à sa façon
L'éclusier qui la veille et partage son lit
L'écluse est comme un coeur qui bat à l'unisson
Et des quais et des ponts de Rouen, de Paris
Jusqu'au fond des égouts où se traite l'eau sale
On peut trouver un homme pour faire une chanson
On est tous un poète quand on fait son travail
Merci à l'égoutier dont j'ignore le nom
Comme le bâtisseur, ingénieur ou maçon
Qui donne à tous ses ponts un air de poésie
Poète de la Seine, il l'est à sa façon
Le jardinier des berges qui la prend pour amie
Toi l'amoureux des quais et des ponts de Paris
Qui les dégustes comme une page d'histoire
Un îlot de repos du corps et de l'esprit
Les témoins d'un amour auquel tu voudrais croire
Souviens-toi que la Seine est bien plus que cette eau
Qui coule sous nos yeux et paraît naturelle
La nature ne fait que des demi-cadeaux
Poètes de la Seine, vous faites la Seine belle
Bruno Grange
Paroles de Bruno Grange, musique de Georges Chelon,1991
Interprétation : Georges Chelon ("Chante la Seine")
_ _ _ _ _
9. Complainte de la Seine (poème mis en musique)
Au fond de la Seine
Il y a de l'or,
Des bateaux rouillés,
Des bijoux, des armes.
Au fond de la Seine
Il y a des morts.
Au fond de la Seine
Il y a des larmes.
Au fond de la Seine
Il y a des fleurs,
De vase et de boue
Elles sont nourries.
Au fond de la Seine
Il y a des coeurs
Qui souffrirent trop
Pour vivre la vie.
Et puis les cailloux
Et des bêtes grises,
L'âme des égoûts
Soufflant des poisons,
Les anneaux jetés
Par des incomprises,
Des pieds qu'une hélice
A coupés du tronc.
Et les fruits maudits
Des ventres stériles,
Les blancs avortés
Que nul n'aima,
Les vomissements
De la grand ville,
Au fond de la Seine
Il y a cela.
Ô Seine clémente
Où vont les cadavres
Ô lit dont les draps
Sont faits de limon.
Fleuve des déchets
Sans fanal ni havre,
Chanteuse berçant
La morgue et les ponts.
Accueille le pauvre
Accueille la femme
Accueille l'ivrogne
Accueille le fou
Mêle leurs sanglots
Au bruit de tes larmes
Et porte leur coeur
Et porte leur coeur
Et porte leur coeur
Parmi les cailloux.
Au fond de la Seine
Il y a de l'or,
Des bateaux rouillés,
Des bijoux, des armes.
Au fond de la Seine
Il y a des morts.
Au fond de la Seine
Il y a des larmes.
Maurice Magre, 1934
Maurice Magre (1877-1941) est un écrivain, poète et dramaturge français (et surtout occitan).
Poème mis en musique par Kurt Weill
Interprétation : par Lotte Lenya (épouse de Kurt Weill), puis par Marianne Faithfull (à écouter ici : http://www.youtube.com/watch?v=_cxcWcFE0zA)
source : Wikipedia :
POÈMES SUR LA SEINE
10. LA SEINE A RENCONTRÉ PARIS
(début de ce très long poème)
Qui est là
toujours là dans la ville
et qui pourtant sans cesse arrive
et qui pourtant sans cesse s’en va
C’est un fleuve répond un enfant
un devineur de devinettes
Et puis l’œil brillant il ajoute
Et le fleuve s’appelle la Seine
quand la ville s’appelle Paris
et la Seine c’est comme une personne
Des fois elle court elle va très vite
elle presse le pas quand tombe le soir
Des fois au printemps elle s’arrête
et vous regarde comme un miroir
et elle pleure si vous pleurez
ou sourit pour vous consoler
et toujours elle éclate de rire
quand arrive le soleil d’été
[...]
Jacques Prévert (recueil : "Choses et autres")
courts extraits d’autres passages, plus loin, qu’on pourrait considérer comme une suite du précédent :
.La Seine
dit un manœuvre
un homme de peine de rêves de muscles et de sueur
La Seine c’est une usine
La Seine c’est le labeur
[...]
La Seine
c’est un fleuve comme un autre
dit d’une voix désabusée un monsieur correct et blasé
l’un des tout premiers passagers
du grand tout dernier bateau-mouche
touristique et pasteurisé
[...]
.. Et la Seine qui l’entend sourit
et puis s’éloigne en chantonnant
Un fleuve comme un autre comme un autre comme un autre
un cours d’eau comme un autre cours d’eau
d’eau des glaciers et des torrents
et des lacs souterrains et des neiges fondues
des nuages disparus
Un fleuve comme un autre
comme la Durance ou le Guadalquivir
ou l’Amazone ou la Moselle
le Rhin la Tamise ou le Nil
Un fleuve comme le fleuve Amour
comme le fleuve Amour
chante la Seine épanouie
et la nuit la Voix lactée l’accompagne de sa tendre
rumeur dorée
et aussi la voix ferrée de son doux fracas coutumier
[...]
Il était une fois la Seine
il était une fois la vie
Jacques Prévert
_ _ _ _ _
11. Le premier frisson d'hiver
(titre proposé)
Que j'aime le premier frisson d'hiver ! le chaume,
Sous le pied du chasseur, refusant de ployer !
Quand vient la pie aux champs que le foin vert embaume,
Au fond du vieux château s'éveille le foyer ;
C'est le temps de la ville. - Oh ! lorsque l'an dernier,
J'y revins, que je vis ce bon Louvre et son dôme,
Paris et sa fumée, et tout ce beau royaume
(J'entends encore au vent les postillons crier),
Que j'aimais ce temps gris, ces passants, et la Seine
Sous ses mille falots assise en souveraine !
J'allais revoir l'hiver. Et toi, ma vie, et toi !
Oh ! dans tes longs regards j'allais tremper mon âme
Je saluais tes murs. Car, qui m'eût dit, madame,
Que votre cœur sitôt avait changé pour moi ?
Alfred de Musset ("Premières poésies" - 1829-1835)
_ _ _ _ _
12. La Seine
La Seine...Les pontons s'en vont vers la colline
Qui borne l'horizon d'un profit bleuissant.
Le fleuve tourne au pied du coteau frémissant
De l'Avril qui renait au sein de l'aubépine
Dans le rouge reflet du soleil qui descend,
Monte, noire, fumeuse et vivante, l'usine.
La fumée et le ciel se teintent de sanguine ;
Une maison se dresse et sourit au passant.
Comme de ce vallon monte la vie, et comme
L'oeuvre de la nature et le travail de l'homme
S'unissent, dans un ton de rouille vespéral !
On devine, parmi la paix et le silence,
La chanson des oiseaux qui sortira du val
Pour apporter l'amour à l'humaine souffrance.
Louis Aragon a écrit ce texte en 1915, à l'âge de 18 ans
_ _ _ _ _
13. Paris 42
Une chanson qui dit un mal inguérissable
Plus triste qu’à minuit la place d’Italie
Pareille au point du jour pour la mélancolie
Plus de rêves aux doigts que le marchand de sable
Annonçant le plaisir comme un marchand d’oublies
Une chanson vulgaire et douce où la voix baisse
Comme un amour d’un soir doutant du lendemain
Une chanson qui prend les femmes par la main
Une chanson qu’on dit sous le métro Barbès
Et qui change à l’Etoile et descend à Jasmin
C’est Paris ce théâtre d’ombre que je porte
Mon Paris qu’on ne peut tout à fait m’avoir pris
Pas plus qu’on ne peut prendre à des lèvres leur cri
Que n’aura-t-il fallu pour m’en mettre à la porte
Arrachez-moi le coeur vous y verrez Paris
C’est de ce Paris-là que j’ai fait mes poèmes
Mes mots ont la couleur étrange de ses toits
La gorge des pigeons y roucoule et chatoie
J’ai plus écrit de toi Paris que de moi-même
Et plus que de vieillir souffert d’être sans toi
Qui n’a pas vu le jour se lever sur la Seine
Ignore ce que c’est que ce déchirement
Quant prise sur le fait la nuit qui se dément
Se défend se défait les yeux rouges obscène
Et Notre-Dame sort des eaux comme un aimant
L’aorte du Pont Neuf frémit comme un orchestre
Où j’entends préluder le vin de mes vingt ans
Il souffle un vent ici qui vient des temps d’antan
Mourir dans les cheveux de la statue équestre
La ville comme un coeur s’y ouvre à deux battants
Le vent murmurera mes vers aux terrains vagues
Il frôlera les bancs où nul ne s’est assis
On l’entendra pleurer sur les quais de Passy
Et les ponts répétant la promesse des bagues
S’en iront fiancés aux rimes que voici
Paris s’éveille et moi pour retrouver ses mythes
Qui nous brûlaient le sang dans notre obscurité
Je mettrais dans mes mains mon visage irrité
Que renaisse le chant que les oiseaux imitent
Et qui répond Paris quant on dit liberté.
Louis Aragon («Il ne m'est Paris que d'Elsa», 1964 - réédition Seghers)
Ce texte a été mis en musique par Lino Léonardi et interprété par Monique Morelli, Jacques Marchais et d’autres chanteurs)
_ _ _ _ _
14. Pour Demain
(extrait)
[...]
La Seine au soleil d’avril danse
comme Cécile au premier bal
ou plutôt roule des pépites
vers les ponts de pierre ou les cribles
Charme sûr La ville est le val
Les quais gais comme en carnaval
vont au devant de la lumière
Elle visite les palais
surgit selon ses jeux ou lois
Moi je l’honore à ma manière
[...]
Louis Aragon ("Feu de joie", 1920)
_ _ _ _ _
15. Sur le Pont Neuf j’ai rencontré…
Sur le Pont Neuf j’ai rencontré
D’où sort cette chanson lointaine
D’une péniche mal ancrée
Ou du métro Samaritaine
Sur le Pont Neuf j’ai rencontré
Sans chien sans canne sans pancarte
Pitié pour les désespérés
Devant qui la foule s’écarte
Sur le Pont Neuf j’ai rencontré
L’ancienne image de moi-même
Qui n’avait d’yeux que pour pleurer
De bouche que pour le blasphème
Sur le Pont Neuf j’ai rencontré
Cette pitoyable apparence
Ce mendiant accaparé
Du seul souci de sa souffrance
Sur le Pont Neuf j’ai rencontré
Fumée aujourd’hui comme alors
Celui que je fus à l’orée
Celui que je fus à l’aurore
Sur le Pont Neuf j’ai rencontré
Semblance d’avant que je naisse
Cet enfant toujours effaré
Le fantôme de ma jeunesse
Sur le Pont Neuf j’ai rencontré
Vingt ans l’empire des mensonges
L’espace d’un miséréré
Ce gamin qui n’était que songes
Sur le Pont Neuf j’ai rencontré
Ce jeune homme et ses bras déserts
Ses lèvres de vent dévorées
Disant les airs qui le grisèrent
Sur le Pont Neuf j’ai rencontré
Baladin du ciel et du coeur
Son front pur et ses goûts outrés
Dans le cri noir des remorqueurs
Sur le Pont Neuf j’ai rencontré
Le joueur qui joua son âme
Comme une colombe égarée
Entre les tours de Notre-Dame
Sur le Pont Neuf j’ai rencontré
Ce spectre de moi qui commence
La ville à l’aval est dorée
A l’amont se meurt la romance
Sur le Pont Neuf j’ai rencontré
Ce pauvre petit mon pareil
Il m’a sur la Seine montré
Au loin les taches de soleil
Sur le Pont Neuf j’ai rencontré
Mon autre au loin ma mascarade
Et dans le jour décoloré
Il m’a dit tout bas Camarade
Sur le Pont Neuf j’ai rencontré
Mon double ignorant et crédule
Et je suis longtemps demeuré
Dans ma propre ombre qui recule
Sur le Pont Neuf j’ai rencontré
Assis à l’usure des pierres
Le refrain que j’ai murmuré
Le reve qui fut ma lumière
Aveugle aveugle rencontré
Passant avec tes regards veufs
Ô mon passé désemparé
Sur le Pont Neuf
Louis Aragon ("Il ne m'est Paris que d'Elsa")
Le Pont-Neuf est le plus ancien pont de Paris, il traverse la Seine à la pointe de l'île de la Cité.
_ _ _ _ _
16. Le Pont Mirabeau
Sous le pont Mirabeau coule la Seine
Et nos amours
Faut-il qu'il m'en souvienne
La joie venait toujours après la peine
Vienne la nuit sonne l'heure
Les jours s'en vont je demeure
Les mains dans les mains restons face à face
Tandis que sous
Le pont de nos bras passe
Des éternels regards l'onde si lasse
Vienne la nuit sonne l'heure
Les jours s'en vont je demeure
L'amour s'en va comme cette eau courante
L'amour s'en va
Comme la vie est lente
Et comme l'Espérance est violente
Vienne la nuit sonne l'heure
Les jours s'en vont je demeure
Passent les jours et passent les semaines
Ni temps passé
Ni les amours reviennent
Sous le pont Mirabeau coule la Seine
Vienne la nuit sonne l'heure
Les jours s'en vont je demeure
Guillaume Apollinaire (Alcools)
_ _ _ _ _
17. Au pied des tours de Notre-Dame
Au pied des tours de Notre-Dame,
La Seine coule entre les quais.
Ah ! le gai, le muguet coquet !
Qui n'a pas son petit bouquet ?
Allons, fleurissez-vous, mesdames !
Mais c'était toi que j'évoquais
Sur le parvis de Notre-Dame ;
N'y reviendras-tu donc jamais ?
Voici le joli moi de mai...
Je me souviens du bel été,
Des bateaux-mouches sur le fleuve
Et de nos nuits de la Cité.
Hélas ! qu'il vente, grêle ou pleuve,
Ma peine est toujours toute neuve :
Elle chemine à mon côté...
De ma chambre du Quai aux Fleurs,
Je vois s'en aller, sous leurs bâches,
Les chalands aux vives couleurs
Tandis qu'un petit remorqueur
Halète, tire, peine et crache
En remontant, à contre-coeur,
L'eau saumâtre de ma douleur...
Francis Carco
_ _ _ _ _
18. Paris
O Paris, ville ouverte
Ainsi qu'une blessure,
Que n'es-tu devenue
De la campagne verte.
Te voilà regardée
Par des yeux ennemis,
De nouvelles oreilles
Écoutent nos vieux bruits.
La Seine est surveillée
Comme du haut d'un puits
Et ses eaux jour et nuit
Coulent emprisonnées.
Tous les siècles français
Si bien pris dans la pierre
Vont-ils pas nous quitter
Dans leur grande colère ?
L'ombre est lourde de têtes
D'un pays étranger.
Voulant rester secrète
Au milieu du danger
S'éteint quelque merveille
Qui préfère mourir
Pour ne pas nous trahir
En demeurant pareille.
Jules Supervielle ("Poèmes de la France malheureuse")
_ _ _ _ _
19. La Seine était verte à ton bras ...
La Seine était verte à ton bras
Plus loin que le pont Mirabeau sous
les collines comme une respiration
La banlieue nous prisait
J'aurais voulu j'aurais
tant besoin que tu penses du bien
Mais le courage maintenant d'
un cœur comme un prisonnier furieux comme un cœur
chassera du lyrique le remords de soi !
L'allongement du jour nous a privé de jours
Le jusant* de la nuit nous détoure les nuits
Ô mon amour paradoxal ! Nous nous privions de poésie
Mais le courage sera de priver le poème
du goût de rien sur le goût de tout.
Michel Deguy
_ _ _ _ _
20. L'aube à l'envers
Le Point-du-Jour avec Paris au large,
Des chants, des tirs, les femmes qu'on " rêvait ",
La Seine claire et la foule qui fait
Sur ce poème un vague essai de charge.
On danse aussi, car tout est dans la marge
Que fait le fleuve à ce livre parfait,
Et si parfois l'on tuait ou buvait,
Le fleuve est sourd et le vin est litharge.
Le Point-du-Jour, mais c'est l'Ouest de Paris !
Un calembour a béni son histoire
D'affreux baisers et d'immondes paris.
En attendant que sonne l'heure noire
Où les bateaux-omnibus et les trains
Ne partent plus, tirez, tirs, fringuez, reins !
Paul Verlaine
_ _ _ _ _
21. Nocturne parisien
À Edmond Lepelletier.
Roule, roule ton flot indolent, morne Seine. –
Sur tes ponts qu’environne une vapeur malsaine
Bien des corps ont passé, morts, horribles, pourris,
Dont les âmes avaient pour meurtrier Paris.
Mais tu n’en traînes pas, en tes ondes glacées,
Autant que ton aspect m’inspire de pensées !
Le Tibre a sur ses bords des ruines qui font
Monter le voyageur vers un passé profond,
Et qui, de lierre noir et de lichen couvertes,
Apparaissent, tas gris, parmi les herbes vertes.
Le gai Guadalquivir rit aux blonds orangers
Et reflète, les soirs, des boléros légers,
Le Pactole a son or, le Bosphore a sa rive
Où vient faire son kief l’odalisque lascive.
Le Rhin est un burgrave, et c’est un troubadour
Que le Lignon, et c’est un ruffian que l’Adour.
Le Nil, au bruit plaintif de ses eaux endormies,
Berce de rêves doux le sommeil des momies.
Le grand Meschascébé, fier de ses joncs sacrés,
Charrie augustement ses îlots mordorés,
Et soudain, beau d’éclairs, de fracas et de fastes,
Splendidement s’écroule en Niagaras vastes.
L’Eurotas, où l’essaim des cygnes familiers
Mêle sa grâce blanche au vert mat des lauriers,
Sous son ciel clair que raie un vol de gypaète,
Rhythmique et caressant, chante ainsi qu’un poète.
Enfin, Ganga, parmi les hauts palmiers tremblants
Et les rouges padmas, marche à pas fiers et lents
En appareil royal, tandis qu’au loin la foule
Le long des temples va, hurlant, vivante houle,
Au claquement massif des cymbales de bois,
Et qu’accroupi, filant ses notes de hautbois,
Du saut de l’antilope agile attendant l’heure,
Le tigre jaune au dos rayé s’étire et pleure.
– Toi, Seine, tu n’as rien. Deux quais, et voilà tout,
Deux quais crasseux, semés de l’un à l’autre bout
D’affreux bouquins moisis et d’une foule insigne
Qui fait dans l’eau des ronds et qui pêche à la ligne.
Oui, mais quand vient le soir, raréfiant enfin
Les passants alourdis de sommeil ou de faim,
Et que le couchant met au ciel des taches rouges,
Qu’il fait bon aux rêveurs descendre de leurs bouges
Et, s’accoudant au pont de la Cité, devant
Notre-Dame, songer, cœur et cheveux au vent !
Les nuages, chassés par la brise nocturne,
Courent, cuivreux et roux, dans l’azur taciturne.
Sur la tête d’un roi du portail, le soleil,
Au moment de mourir, pose un baiser vermeil.
L’Hirondelle s’enfuit à l’approche de l’ombre.
Et l’on voit voleter la chauve-souris sombre.
Tout bruit s’apaise autour. À peine un vague son
Dit que la ville est là qui chante sa chanson,
Qui lèche ses tyrans et qui mord ses victimes ;
Et c’est l’aube des vols, des amours et des crimes.
– Puis, tout à coup, ainsi qu’un ténor effaré
Lançant dans l’air bruni son cri désespéré,
Son cri qui se lamente, et se prolonge, et crie,
Éclate en quelque coin l’orgue de Barbarie :
Il brame un de ces airs, romances ou polkas,
Qu’enfants nous tapotions sur nos harmonicas
Et qui font, lents ou vifs, réjouissants ou tristes,
Vibrer l’âme aux proscrits, aux femmes, aux artistes.
C’est écorché, c’est faux, c’est horrible, c’est dur,
Et donnerait la fièvre à Rossini, pour sûr ;
Ces rires sont traînés, ces plaintes sont hachées ;
Sur une clef de sol impossible juchées,
Les notes ont un rhume et les do sont des la,
Mais qu’importe ! l’on pleure en entendant cela !
Mais l’esprit, transporté dans le pays des rêves,
Sent à ces vieux accords couler en lui des sèves ;
La pitié monte au cœur et les larmes aux yeux,
Et l’on voudrait pouvoir goûter la paix des cieux,
Et dans une harmonie étrange et fantastique
Qui tient de la musique et tient de la plastique,
L’âme, les inondant de lumière et de chant,
Mêle les sons de l’orgue aux rayons du couchant !
– Et puis l’orgue s’éloigne, et puis c’est le silence,
Et la nuit terne arrive et Vénus se balance
Sur une molle nue au fond des cieux obscurs :
On allume les becs de gaz le long des murs.
Et l’astre et les flambeaux font des zigzags fantasques
Dans le fleuve plus noir que le velours des masques ;
Et le contemplateur sur le haut garde-fou
Par l’air et par les ans rouillé comme un vieux sou
Se penche, en proie aux vents néfastes de l’abîme.
Pensée, espoir serein, ambition sublime,
Tout, jusqu’au souvenir, tout s’envole, tout fuit,
Et l’on est seul avec Paris, l’Onde et la Nuit !
– Sinistre trinité ! De l’ombre dures portes !
Mané-Thécel-Pharès des illusions mortes !
Vous êtes toutes trois, ô Goules de malheur,
Si terribles, que l’Homme, ivre de la douleur
Que lui font en perçant sa chair vos doigts de spectre,
L’Homme, espèce d’Oreste à qui manque une Électre,
Sous la fatalité de votre regard creux
Ne peut rien et va droit au précipice affreux ;
Et vous êtes aussi toutes trois si jalouses
De tuer et d’offrir au grand Ver des épouses
Qu’on ne sait que choisir entre vos trois horreurs,
Et si l’on craindrait moins périr par les terreurs
Des Ténèbres que sous l’Eau sourde, l’Eau profonde,
Ou dans tes bras fardés, Paris, reine du monde !
– Et tu coules toujours, Seine, et, tout en rampant,
Tu traînes dans Paris ton cours de vieux serpent,
De vieux serpent boueux, emportant vers tes havres
Tes cargaisons de bois, de houille et de cadavres !
Paul Verlaine («Choix de poésies», Les Cahiers rouges, Grasset)
_ _ _ _ _
22. Paris (titre proposé)
(passage du poème «La pente de la rêverie»)
[...]
Paris, les grands ormeaux, maison, dôme, chaumière,
Tout flottait à mes yeux dans la riche lumière
De cet astre de mai dont le rayon charmant
Au bout de tout brin d'herbe allume un diamant !
Je me laissais aller à ces trois harmonies,
Printemps, matin, enfance, en ma retraite unies ;
La Seine, ainsi que moi, laissait son flot vermeil
Suivre nonchalamment sa pente, et le soleil
Faisait évaporer à la fois sur les grèves
L'eau du fleuve en brouillards et ma pensée en rêves !
[...]
Victor Hugo
_ _ _ _ _
23. J'aime ma maison ... (titre proposé)
"J'aime ma maison où j'ai grandi. De mes fenêtres, je vois la Seine qui coule, le long de mon jardin, derrière la route, presque chez moi, la grande et large Seine, qui va de Rouen au Havre, couverte de bateaux qui passent.
A gauche, là-bas, Rouen, la vaste ville aux toits bleus, sous le peuple pointu des clochers gothiques. Ils sont innombrables, frêles ou larges, dominés par la flèche de fonte de la cathédrale, et pleins de cloches qui sonnent dans l'air bleu des belles matinées, jetant jusqu'à moi leur doux et lointain bourdonnement de fer, leur chant d'airain que la brise m'apporte, tantôt plus fort et tantôt plus affaibli, suivant qu'elle s'éveille ou s'assoupit.
Comme il faisait bon ce matin. Vers onze heures, un long convoi de navires, traînés par un remorqueur, gros comme une mouche, et qui râlait de peine en vomissant une fumée épaisse, défila devant ma grille.
Après deux goélettes anglaises, dont le pavillon rouge ondoyait sur le ciel, venait un superbe trois-mâts brésilien, tout blanc, admirablement propre et luisant. Je le saluai, je ne sais pourquoi, tant ce navire me fit plaisir à voir".
Guy de Maupassant («Le Horla»)
_ _ _ _ _
24. Rouen (titre proposé)
Ils venaient de s'arrêter aux deux tiers de la montée, à un endroit renommé pour la vue, où l'on conduit tous les voyageurs. On dominait l'immense vallée, longue et large, que le fleuve clair parcourait d'un bout à l'autre, avec de grandes ondulations.
On le voyait venir de là-bas, taché par des îles nombreuses et décrivant une courbe avant de traverser Rouen. Puis la ville apparaissait sur la rive droite, un peu noyée dans la brume matinale, avec des éclats de soleil sur ses toits, et ses mille clochers légers, pointus ou trapus, frêles et travaillés comme des bijoux géants, ses tours carrées ou rondes coiffées de couronnes héraldiques, ses beffrois, ses clochetons, tout le peuple gothique des sommets d'églises que dominait la flèche aiguë de la cathédrale [...]
Guy de Maupassant («Bel-ami»)
source principale de ces deux extraits :
http://www.dboc.net/rouen/oc_rouen_citation.php
_ _ _ _ _
25. Devant nous la Seine (titre proposé)
Devant nous la Seine se déroulait, ondulante, semée d'îles, bordée à droite de blanches falaises que couronnait une forêt, à gauche de prairies immenses qu'une autre forêt limitait, là-bas, tout là-bas.
De place en place, des grands navires à l'ancre le long des berges du large fleuve. Trois énormes vapeurs s'en allaient, à la queue leu leu, vers Le Havre ; et un chapelet de bâtiments, formé d'un trois-mâts, de deux goélettes et d'un brick, remontait vers Rouen, traîné par un petit remorqueur vomissant un nuage de fumée noire."
Guy de Maupassant (dans «Un normand», nouvelle publiée dans «Gil Blas» en 1882)
source principale de ce passage :
http://www.sportnat.com/lapouneur/rando/seine/fil/fil.htm
_ _ _ _ _
26. La Seine à Argenteuil (titre proposé)
Comme c'était simple, et bon, et difficile de vivre ainsi, entre le bureau à Paris et la rivière à Argenteuil. Ma grande, ma seule, mon absorbante passion, pendant dix ans, ce fut la Seine. Ah l la belle, calme, variée et puante rivière pleine de mirage et d'immondices. Je l'ai tant aimée; je crois, parce qu'elle m'a donné, me semble-t-il, le sens de la vie. Ah l les promenades le long des berges fleuries, mes amies les grenouilles qui rêvaient, le ventre au frais, sur une feuille de nénuphar, et les lis d'eau coquets et frêles, au milieu des grandes herbes fines qui m'ouvraient soudain, derrière un saule, un feuillet d'album japonais quand le martin-pêcheur fuyait devant moi comme une flamme bleue ! Ai-je aimé tout cela, d'un amour instinctif des yeux qui se répandait dans tout mon corps en une joie naturelle et profonde.
Comme d'autres ont des souvenirs de nuits tendres, j'ai des souvenirs de levers de soleil dans les brumes matinales, flottantes, errantes vapeurs, blanches comme des mortes avant l'aurore, puis, au premier rayon glissant sur les prairies, illuminées de rose à ravir le coeur; et j'ai des souvenirs de lune argentant l'eau frémissante et courante, d'une lueur qui faisait fleurir tous les rêves.
Et tout cela, symbole de l'éternelle illusion, naissait pour moi sur de l'eau croupie qui charriait vers la mer toutes les ordures de Paris.
Guy de Maupassant (dans «Mouche»)
Mouche est une nouvelle de Guy de Maupassant, publiée en 1890 dans L'Écho de Paris(1890), puis dans le recueil "L'Inutile Beauté"sous le titre "Mouche, Souvenir d'un canotier".
L'action se situe à Argenteuil dans le Val-d'Oise.
passage tiré du texte ici :
http://www.per-bast.com/classement/litterature/181-mouche-guy-de-maupassant
_ _ _ _ _
27. La Seine vue par un peintre
"Nous avons été par une journée superbe à Canteleu, un village aux environs de Déville, sur une haute colline, nous avons vu le paysage le plus splendide qu'un peintre puisse rêver, la vue de Rouen dans le lointain avec la seine se déroulant calme comme une glace, des coteaux ensoleillés, des premiers plans splendides, c'était féérique."
Camille Pissaro (dans une lettre à son fils, en octobre 1883)

Pissaro : Le pont Boieldieu à Rouen (1896) - source du texte et de l’image :
http://www.za-gay.org/forum/viewtopic/24625/exposition-une-ville-pour-l-impressionnisme-a-rouen/0/
28. Javert (titre proposé)
Il s'enfonça dans les rues silencieuses. Cependant, il suivait une direction. Il coupa par le plus court vers la Seine, gagna le quai des Ormes, longea le quai, dépassa la Grève, et s'arrêta, à quelque distance du poste de la place du Châtelet, à l'angle du pont Notre-Dame. La Seine fait là, entre le pont Notre-Dame et le Pont au Change d'une part, et d'autre part entre le quai de la Mégisserie et le quai aux Fleurs, une sorte de lac carré traversé par un rapide.
Victor Hugo ("Les Misérables")
_ _ _ _ _
29. C’est un petit village ...
(titre proposé pour ce passage)
C’est un petit village, ou plutôt un hameau,
Bâti sur le penchant d’un long rang de collines,
D’où l’œil s’égare au loin dans les plaines voisines.
La Seine, au pied des monts que son flot vient laver,
Voit du sein de ses eaux vingt îles s’élever,
Qui, partageant son cours en diverses manières,
D’une rivière seule y forment vingt rivières.
Tous ses bords sont couverts de saules non plantés,
Et de noyers souvent du passant insultés.
Le village au-dessus forme un amphithéâtre :
L’habitant ne connaît ni la chaux ni le plâtre ;
Et dans le roc, qui cède et se coupe aisément,
Chacun sait de sa main creuser son logement.
Nicolas Boileau, Épitre VI («Épitres», 1677)
_ _ _ _ _
30. La Seine de Paris
De ceux qui préférant à leurs regrets les fleuves
et à leurs souvenirs les profonds monuments
aiment l'eau qui descend au partage des villes,
la Seine de Paris me sait le plus fidèle
à ses quais adoucis de livres. Pas un souffle
qui ne vienne vaincu par les mains des remous
sans me trouver prêt à le prendre et à relire
dans ses cheveux le chant des montagnes, pas un
silence dans les nuits d'été où je ne glisse
comme une feuille entre l'air et le flot, pas une aile
blanche d'oiseau remontant de la mer
ne longe le soleil sans m'arracher d'un cri
strident à ma pesanteur monotone! Les piliers
sont lourds après le pas inutile et je plonge
par eux jusqu'à la terre et quand
je remonte et ruisselle et m'ébroue,
j'invoque un dieu qui regarde aux fenêtres
et brille de plaisir dans les vitres caché.
Protégé par ses feux je lutte de vitesse
en moi-même avec l'eau qui ne veut pas attendre
et du fardeau des bruits de pas et de voitures
et de marteaux sur des tringles et de voix
tant de rapidité me délivre ... Les quais
et les tours sont déjà loin lorsque soudain
je les retrouve, recouvrant comme les siècles,
avec autant d'amour et de terreur, vague après vague,
méandres de l'esprit la courbe de mon fleuve.
Jean Tardieu («Le Témoin invisible», 1943)
_ _ _ _ _
31. Là-bas, sur un coteau crayeux
Là-bas, sur un coteau crayeux, une charrue
Gravite, en grimaçant de l’âge et de l’essieu.
Les avoines d’hiver commencent à pointer;
Les canards migrateurs traversent la vallée;
Ils nicheront, ce soir, aux méandres du fleuve;
La marée affluera dans les roseaux des berges;
Honfleur, brulôt éteint, luira, crépusculaire;
Puis jaillira l’aurore...; âpre, la haute mer
Fera chanter le jour dans les agrès du bac;
Alors les ramasseurs de pommes par les cours
Élèveront des feux lents sur les côtes bleues;
Ils rosiront leurs doigts à la flamme; l’espace
Dilatera le ciel dont strient l’azur les boats.
Ah ! mon cœur tout changeant, tout retrait, pose-toi
Sur mes jours, comme ces mouettes sur le fleuve...
Je ne crains ni le soir, ni sa brume océane;
Je voudrais, au contraire, en la nuit me répandre,
Devenir cette baie où la Seine s’achève,
Couler, mon cœur, dormir sur le flux de mes rêves,
Comme vont ces oiseaux, en l’étendue amère,
Se laisser, jusqu’à l’aube glacée, bercer par
La palpitation profuse de la mer.
André Druelle («Florilège poétique» - L’Amitié par le Livre)
_ _ _ _ _
32. Le rêve du poète
Ce serait sur les bords de la Seine. Je vois
Notre chalet, voilé par un bouquet de bois.
Un hamac au jardin, un bateau sur le fleuve.
Pas d'autre compagnon qu'un chien de Terre-Neuve
Qu'elle aimerait et dont je serais bien jaloux.
Des faïences à fleurs pendraient après des clous ;
Puis beaucoup de chapeaux de paille et des ombrelles.
Sous leurs papiers chinois les murs seraient si frêles
Que même, en travaillant à travers la cloison
Je l'entendrais toujours errer par la maison
Et traîner dans l'étroit escalier sa pantoufle.
Les miroirs de ma chambre auraient senti son souffle
Et souvent réfléchi son visage, charmés.
Elle aurait effleuré tout de ses doigts aimés.
Et ces bruits, ces reflets, ces parfums, venant d'elle,
Ne me permettraient pas d'être une heure infidèle.
Enfin, quand, poursuivant un vers capricieux,
Je serais là, pensif et la main sur les yeux,
Elle viendrait, sachant pourtant que c'est un crime,
Pour lire mon poème et me souffler ma rime,
Derrière moi, sans bruit, sur la pointe des pieds.
Moi, qui ne veux pas voir mes secrets épiés,
Je me retournerais avec un air farouche ;
Mais son gentil baiser me fermerait la bouche.
- Et dans les bois voisins, inondés de rayons,
Précédés du gros chien, nous nous promènerions,
Moi, vêtu de coutil, elle, en toilette blanche,
Et j'envelopperais sa taille, et sous sa manche
Ma main caresserait la rondeur de son bras.
On ferait des bouquets, et, quand nous serions las
On rejoindrait, toujours suivis du chien qui jappe,
La table mise, avec des roses sur la nappe,
Près du bosquet criblé par le soleil couchant ;
Et, tout en s'envoyant des baisers en mangeant,
Tout en s'interrompant pour se dire : Je t'aime !
On assaisonnerait des fraises à la crème,
Et l'on bavarderait comme des étourdis
Jusqu'à ce que la nuit descende...
- O Paradis !
François Coppée («Promenades et Intérieurs»)
_ _ _ _ _
33. Valvins
sonnet
Si tu veux dénouer la forêt qui t'aère
Heureuse, tu te fonds aux feuilles, si tu es
Dans la fluide yole*, à jamais littéraire,
Traînant quelques soleils ardemment situés
Aux blancheurs de son flanc que la Seine caresse
Émue, ou pressentant l'après-midi chanté,
Selon que le grand bois trempe une longue tresse,
Et mélange ta voile au meilleur de l'été.
Mais toujours près de toi que le silence livre
Aux cris multipliés de tout le brut azur,
L'ombre de quelque page éparse d'aucun livre
Tremble, reflet de voile vagabonde sur
La poudreuse peau de la rivière verte
Parmi le long regard de la Seine entr'ouverte.
Paul Valéry ("Album de vers anciens", Paris, Les Cahiers des Amis des livres, 1920)
* Une yole est un genre de barque rapide, légère et étroite, en général à rames ou à aviron mais parfois à voile.
Valvins, en bord de Seine, est un village proche de Fontainebleau où Mallarmé avait une maison de campagne. Il y pratiquait la yole*.
Ce poème de Paul Valéry lui est adressé
L'aurore grelottante en robe rose et verte
S'avançait lentement sur la Seine déserte,
Et le sombre Paris, en se frottant les yeux,
Empoignait ses outils, vieillard laborieux ...
Baudelaire (Le crépuscule du matin)
La Seine est surveillée
Comme du haut d'un puits
Et ses eaux jour et nuit
Coulent emprisonnées.
Jules Supervielle
... le fleuve arrondissait sa courbe au pied des collines vertes, et les îles, de forme oblongue, semblaient sur l'eau de grands poissons noirs arrêtés ... (la Seine à Rouen)
Gustave Flaubert («Madame Bovary»)
J’ai le mal de la Seine
Qui écoute mes peines ...
Mouloudji
Le ciel était blanc sur la Seine assise entre ses grues, comme entre ses jouets une enfant triste.
Françoise Sagan («Un certain sourire»)
L’eau est une flamme mouillée ...
Novalis
Si je meurs ici, qu'on m'emporte
Près de la Seine au ciel léger,
J'aurai peur de n'être pas morte
Si je dors sous des orangers...
Anna de Noailles ("Les vivants et les morts")
Qu'il fait bon regarder la Seine lente et noire
En silence rouler sous les vieux ponts sa moire,
Et les reflets tremblants des feux traîner sur l'eau
Comme les pleurs d'argent sur le drap d'un tombeau !
René-François Sully Prudhomme
La Seine, ainsi que moi, laissait son flot vermeil
Suivre nonchalamment sa pente, et le soleil
Faisait évaporer à la fois sur les grèves
L’eau du fleuve en brouillards et ma pensée en rêves.
Victor Hugo
quelques images et reflets sonores de l’eau qui court
La source en corbeille
Dédie à l’abeille
Son jeu de cristal.
Gilbert Sore
Le ruisseau traîne un psaume en l’orgue des roseaux.
Paul Fort
Il perd un jardin par semaine
Mon p'tit coin là-bas près d'la Seine
Jean Ferrat
Loire fameux, qui, ta petite source,
Enfles de maints gros fleuves et ruisseaux,
Et qui de loin coules tes claires eaux
En l'Océan d'une assez vive course ...
Joachim du Bellay
La rivière
change
de
déshabillé
avec
chaque
tournant
Malcolm de Chazal
(extrait de "Sens magique")
D’AUTRES EAUX COURANTES
-
34.Au bord de l’eau - René-François Sully-Prudhomme
-
35.Sur l’eau - René-François Sully-Prudhomme
-
36.Le bateau ivre - Arthur Rimbaud
-
37.Le Fleuve - Albert Samain
-
38.Le fleuve - Charles Cros
-
39.Le miroir - Michel Deguy
-
40.Mississipi - Blaise Cendrars
-
41.Le murmure du fleuve - Marcel Marchandeau
-
42.Si j’étais gabarre ou chaland - Jean de la Ville de Mirmont
-
43.La Sorgue - René Char
-
44.La rivière endormie - Claude Roy
-
45.Été : les truites - Maurice Fombeure
-
46.Que tu es simple et claire - Charles Van Lerberghe
-
47.Le ruisseau - Jacques Prévert
-
48.La Loire au plus près - Claudia Adrover
-
49.Printemps kurde - Nicolas Bouvier
-
50.Les rivières claires - Robert Desnos
-
51.Bièvre - Victor Hugo
-
52.Memento (ou La Bièvre) - Jean Moréas
-
53.Les bords de Marne - Anna de Noailles
-
54.Tu cours superbe, ô Rhosne, flourissant - Annie Salager
-
55.Tu cours superbe, ô Rhône, florissant - Maurice Scève
-
56.L'ombre des arbres dans la rivière embrumée - Paul Verlaine
-
57.Au fleuve - André Fontainas
-
58.Les ziaux - Raymond Queneau
TEXTE EN PROSE
-
59.L'Èvre - Julien Gracq
TEXTE EN MARGE
-
60.Une pleine eau - Maurice Mac-Nab
Dans certains textes, les passages qui semblent les plus adaptés
pour le collège ont été mis en bleu
D’AUTRES EAUX COURANTES
34. Au bord de l'eau
S'asseoir tous deux au bord d'un flot qui passe ,
Le voir passer ;
Tous deux , s'il glisse un nuage en l'espace ,
Le voir glisser ;
A l'horizon , s'il fume un toit de chaume ,
Le voir fumer ;
Aux alentours , si quelque fleur embaume ,
S'en embaumer ;
Si quelque fruit , où les abeilles goûtent ,
Tente , y goûter ;
Si quelque oiseau , dans les bois qui l'écoutent ,
Chante , écouter...
Entendre au pied du saule où l'eau murmure
L'eau murmurer ;
Ne pas sentir , tant que ce rêve dure ,
Le temps durer ;
Mais n'apportant de passion profonde
Qu'à s'adorer ,
Sans nul souci des querelles du monde ,
Les ignorer ;
Et seuls , heureux devant tout ce qui lasse ,
Sans se lasser ,
Sentir l'amour , devant tout ce qui passe ,
Ne point passer !
René-François Sully-Prudhomme («Poésies 1872-1878», éditions Alphonse Lemerre)
_ _ _ _ _
35. Sur l’eau
(sonnet)
Je n’entends que le bruit de la rive et de l’eau,
Le chagrin résigné d’une source qui pleure
Ou d’un rocher qui verse une larme par heure,
Et le vague frisson des feuilles de bouleau.
Je ne sens pas le fleuve entraîner le bateau,
Mais c’est le bord fleuri qui passe, et je demeure ;
Et dans le flot profond, que de mes yeux j’effleure,
Le ciel bleu renversé tremble comme un rideau.
On dirait que cette onde en sommeillant serpente,
Oscille, et ne sait plus le côté de la pente :
Une fleur qu’on y pose hésite à le choisir.
Et, comme cette fleur, tout ce que l’homme envie
Peut se venir poser sur le flot de ma vie,
Sans désormais m’apprendre où penche mon désir.
René-François Sully-Prudhomme («Poésies 1872-1878», éditions Alphonse Lemerre)
_ _ _ _ _
36. Le bateau ivre
Comme je descendais des Fleuves impassibles,
Je ne me sentis plus guidé par les haleurs :
Des Peaux-Rouges criards les avaient pris pour cibles,
Les ayant cloués nus aux poteaux de couleurs.
J’étais insoucieux de tous les équipages,
Porteur de blés flamands ou de cotons anglais.
Quand avec mes haleurs ont fini ces tapages,
Les Fleuves m’ont laissé descendre où je voulais.
Dans les clapotements furieux des marées,
Moi, l’autre hiver, plus sourd que les cerveaux d’enfants,
Je courus ! Et les Péninsules démarrées
N’ont pas subi tohu-bohus plus triomphants.
La tempête a béni mes éveils maritimes.
Plus léger qu’un bouchon j’ai dansé sur les flots
Qu’on appelle rouleurs éternels de victimes,
Dix nuits, sans regretter l’oeil niais des falots !
Plus douce qu’aux enfants la chair des pommes sûres,
L’eau verte pénétra ma coque de sapin
Et des taches de vins bleus et des vomissures
Me lava, dispersant gouvernail et grappin.
Et dès lors, je me suis baigné dans le Poème
De la Mer, infusé d’astres, et lactescent,
Dévorant les azurs verts ; où, flottaison blême
Et ravie, un noyé pensif parfois descend ;
Où, teignant tout à coup les bleuités, délires
Et rhythmes lents sous les rutilements du jour,
Plus fortes que l’alcool, plus vastes que nos lyres,
Fermentent les rousseurs amères de l’amour !
Je sais les cieux crevant en éclairs, et les trombes
Et les ressacs et les courants : je sais le soir,
L’Aube exaltée ainsi qu’un peuple de colombes,
Et j’ai vu quelquefois ce que l’homme a cru voir !
J’ai vu le soleil bas, taché d’horreurs mystiques,
Illuminant de longs figements violets,
Pareils à des acteurs de drames très antiques
Les flots roulant au loin leurs frissons de volets !
J’ai rêvé la nuit verte aux neiges éblouies,
Baiser montant aux yeux des mers avec lenteurs,
La circulation des sèves inouïes,
Et l’éveil jaune et bleu des phosphores chanteurs !
J’ai suivi, des mois pleins, pareille aux vacheries
Hystériques, la houle à l’assaut des récifs,
Sans songer que les pieds lumineux des Maries
Pussent forcer le mufle aux Océans poussifs !
J’ai heurté, savez-vous, d’incroyables Florides
Mêlant aux fleurs des yeux de panthères à peaux
D’hommes ! Des arcs-en-ciel tendus comme des brides
Sous l’horizon des mers, à de glauques troupeaux !
J’ai vu fermenter les marais énormes, nasses
Où pourrit dans les joncs tout un Léviathan !
Des écroulements d’eaux au milieu des bonaces,
Et les lointains vers les gouffres cataractant !
Glaciers, soleils d’argent, flots nacreux, cieux de braises !
Échouages hideux au fond des golfes bruns
Où les serpents géants dévorés des punaises
Choient, des arbres tordus, avec de noirs parfums !
J’aurais voulu montrer aux enfants ces dorades
Du flot bleu, ces poissons d’or, ces poissons chantants.
- Des écumes de fleurs ont bercé mes dérades
Et d’ineffables vents m’ont ailé par instants.
Parfois, martyr lassé des pôles et des zones,
La mer dont le sanglot faisait mon roulis doux
Montait vers moi ses fleurs d’ombre aux ventouses jaunes
Et je restais, ainsi qu’une femme à genoux …
Presque île, ballottant sur mes bords les querelles
Et les fientes d’oiseaux clabaudeurs aux yeux blonds.
Et je voguais, lorsqu’à travers mes liens frêles
Des noyés descendaient dormir, à reculons !
Or moi, bateau perdu sous les cheveux des anses,
Jeté par l’ouragan dans l’éther sans oiseau,
Moi dont les Monitors et les voiliers des Hanses
N’auraient pas repêché la carcasse ivre d’eau ;
Libre, fumant, monté de brumes violettes,
Moi qui trouais le ciel rougeoyant comme un mur
Qui porte, confiture exquise aux bons poètes,
Des lichens de soleil et des morves d’azur ;
Qui courais, taché de lunules électriques,
Planche folle, escorté des hippocampes noirs,
Quand les juillets faisaient crouler à coups de triques
Les cieux ultramarins aux ardents entonnoirs ;
Moi qui tremblais, sentant geindre à cinquante lieues
Le rut des Béhémots et les Maelstroms épais,
Fileur éternel des immobilités bleues,
Je regrette l’Europe aux anciens parapets !
J’ai vu des archipels sidéraux ! et des îles
Dont les cieux délirants sont ouverts au vogueur :
- Est-ce en ces nuits sans fonds que tu dors et t’exiles,
Million d’oiseaux d’or, ô future Vigueur ?
Mais, vrai, j’ai trop pleuré ! Les Aubes sont navrantes.
Toute lune est atroce et tout soleil amer :
L’âcre amour m’a gonflé de torpeurs enivrantes.
Ô que ma quille éclate ! Ô que j’aille à la mer !
Si je désire une eau d’Europe, c’est la flache
Noire et froide où vers le crépuscule embaumé
Un enfant accroupi plein de tristesse, lâche
Un bateau frêle comme un papillon de mai.
Je ne puis plus, baigné de vos langueurs, ô lames,
Enlever leur sillage aux porteurs de cotons,
Ni traverser l’orgueil des drapeaux et des flammes,
Ni nager sous les yeux horribles des pontons.
Arthur Rimbaud, 1871 (" Poésies")
_ _ _ _ _
Deux textes-fleuves :
Comme une épopée tumultueuse et passionnée, la vie d’un fleuve, de la source à l’embouchure, de la «naissance» la «mort», vue, imaginée par deux poètes aux styles ici comparables.
On peut en proposer des passages aux grandes classes, une lecture ou une simple écoute ...
37. Le Fleuve
Conçu dans l’ombre aux flancs augustes de la Terre,
Le Fleuve prend sa vie aux sources du mystère.
Il est le fils des monts déserts et des glaciers ;
Et les vieux rocs pensifs, farouches nourriciers
Du limpide cristal distillé par la voûte,
Dans l’ombre, de longs jours l’abreuvent goutte à goutte,
L’écoutent gazouiller dans son lit de cailloux,
Si faible encore, avec un murmure très doux,
Et suivent, attendris, ses limpides manèges
Parmi la radieuse innocence des neiges.
Tel il grandit, gardé par l’antre paternel,
Pur de la pureté des glaces - près du ciel.
Mais déjà, frémissant de conquérir l’espace,
Il s’élance, et ruisseau turbulent et vorace,
Emporte en bouillonnant dans ses flots confondus
Des herbes, des rochers et des sapins tordus ;
Puis, torrent blanc d’écume, il déserte les cimes ;
Jaloux de l’avalanche, il se rue aux abîmes,
Et sur les rocs fumants, ivre et précipité,
S’écrase et tombe en des cascades de clarté !
Au fond des ravins noirs sa fureur s’est éteinte.
Il respire à présent, car la plaine est atteinte,
La plaine pacifique aux horizons d’épis.
Il promène, étalé, de longs jours assoupis
Parmi les terrains roux, les vergers, les pâtures,
Le décor symétrique et calme des cultures,
Et coule monotone et pareil aux boeufs lents
Attelés sur la route aux chars de foin tremblants.
Le rire de l’Été rayonne sur ses berges.
Des troupeaux çà et là boivent à ses flots vierges ;
Il rencontre, en passant, des villages, des bourgs ;
Maints châteaux dans ses eaux claires mirent leurs tours
Et, charmant, il s’attarde, il serpente, il chatoie,
Une frange de fleurs à sa robe de soie.
Pourtant il reste en lui des flammes du passé ;
Et, parfois, quand l’Hiver plus fort l’a terrassé,
Comme un taureau qu’on couche en pesant sur ses cornes,
Tout à coup, s’échappant, crevant les glaçons mornes,
Balayant l’horizon, brisant tout, tordant tout,
Faisant sauter les ponts de pierre d’un seul coup
- Car l’âme des fléaux géants est dans son âme -
Il arrive comme le vent, comme la flamme !
Et les peuples, béants d’horreur sur les coteaux,
Écoutent dans la nuit passer ses grandes eaux,
Jusqu’au jour où, lion fatigué de ravages,
Il retourne à pas lents dormir sur ses rivages,
Et reprend, souriant sous l’azur attiédi,
Le rêve nonchalant de ses après-midi.
Cependant il s’étend. Ses eaux autoritaires
Rançonnent durement les ruisseaux tributaires,
Et riche de ses flots par des flots augmentés,
Il marche comme un roi vainqueur vers les cités.
Chargé d’orgueil, au loin, sur les plaines fertiles,
Il regarde traîner son manteau semé d’îles,
Et, superbe, à plaisir prodiguant les détours,
S’avance vers la ville aux immenses faubourgs
Où, plein de majesté, comme les patriarches,
Il entre, glorieux, sous la splendeur des arches !
La Ville avec orgueil, du haut des grands quais blancs
Regarde s’avancer ses flots nobles et lents.
Les vieux palais bâtis par les races lointaines
Suspendent sur ses eaux leurs terrasses hautaines.
Les rêveurs éblouis vont voir, les soirs vermeils,
Sur ses flots somptueux descendre les soleils ;
Et la nuit jette au fond de ses ondes funèbres
Des secrets qu’il emporte à Dieu dans les ténèbres.
Un peuple de bateaux le sillonnent sans fin.
Il apporte le blé, le fer, le bois, le vin,
Et fait sur son chemin bénir ses eaux royales
Par les grands bras levés des saintes cathédrales !
Il est religieux, sacré, fécond, puissant,
Et coule au coeur des nations comme le sang.
L’horizon s’élargit, respectueux ; la Terre,
Orgueilleuse de lui, comme une bonne mère,
Le salue au passage avec ses bois, ses champs,
Ses vignes, ses moissons et ses jardins penchants.
L’âge l’a couronné de sagesse ; il respire
La brise parfumée aux fleurs de son empire,
Et revêtu de force et de sérénité
Marche tout plein déjà de sa divinité.
Triomphateur altier consacré par l’histoire,
Charriant sous maint pont sonore un flot de gloire,
Il va de plus en plus magnifique et profond.
Déjà de hauts vaisseaux apparaissent qui font
Palpiter sur ses eaux des gonflements de voiles.
Chaque nuit sa splendeur réfléchit plus d’étoiles.
Le vent lointain qui vient d’horizons ignorés
Soulève vers le soir ses cheveux azurés.
L’Océan ! L’Océan ! ... Déjà vers sa narine
Monte en souffle puissant la grande odeur marine.
Il tressaille, il s’émeut ; déjà de sourds reflux
Troublent obscurément ses flots irrésolus.
Il a compris ; là-bas l’attend l’ultime épreuve.
Au fils des monts altiers, roi des plaines, au Fleuve,
La mort dresse là-bas le lit universel,
Brodé d’écume blanche et parfumé de sel.
Alors multipliant ses ondes épandues,
Superbe, débordant au loin les étendues,
Il étreint l’horizon immense peu à peu
De l’attendrissement d’un magnifique adieu ;
Puis, enlacé déjà par l’Épouse fatale,
Dans un effort suprême, il grandit, il s’étale
Et, pareil à la mer, qu’inonde un couchant d’or,
Il entre dans l’orgueil sublime de sa mort.
Albert Samain, 1889
_ _ _ _ _
38. Le fleuve
À Monsieur Ernest Legouvé
De ce très long texte on a découpé en bleu les passages parfois proposés en classe et dont chacun pourrait, isolé ou avec un rappel à l’ensemble, constituer un poème à part entière
Ravi des souvenirs clairs de l'eau dont s'abreuve
La terre, j'ai conçu cette chanson du Fleuve.
Derrière l'horizon sans fin, plus loin, plus loin
Les montagnes, sur leurs sommets que nul témoin
N'a vus, condensent l'eau que le vent leur envoie.
D'où le glacier, sans cesse accru, mais qui se broie
Par la base et qui fond en rongeant le roc dur.
Plus bas, non loin des verts sapins, le rire pur
Des sources court parmi les mousses irisées
Et sur le sable fin pris aux roches usées.
Du ravin de là-bas sort un autre courant,
Et mille encore. Ainsi se grossit le torrent
Qui descend vers la plaine et commence le Fleuve.
Mais l'eau court trop brutale et d'une ardeur trop neuve
Pour féconder le sol. Sur ces bords déchirés,
Aubépines, lavande et thym, genêts dorés
Trouvent seuls un abri dans les fentes des pierres.
Voici que le torrent heurte en bas les barrières
De sable et de rochers par lui-même traînés.
C'est la plaine. Il s'y perd en chemins détournés
Qui calment sa fureur. Et quelques petits arbres
Suivent l'eau qui bruit sur les grès et les marbres.
Ces collines, derniers remous des monts géants,
Flots figés du granit coulant en océans,
Ces coteaux, maintenant verts, se jaspent de taches
Blanches et rousses qui marchent. Ce sont les vaches
Ou, plus près, le petit bétail. Le tintement
Des clochettes se mêle au murmure endormant
De l'eau.
Les peupliers pointus aiment les rives
Plates. Voici déjà que leurs files passives
Escortent çà et là le Fleuve calme et fort.
Les champs sont possédés par les puissants. Au bord
Ceux qui n'ont pas l'espoir des moissons vont en foule
Attendre l'imprévu qu'apporte l'eau qui coule :
Paillettes d'or, saphirs, diamants et rubis,
Que les roches, après tant d'orages subis,
Abandonnent du fond de leur masse minée,
Sous l'influx caressant de l'eau froide, obstinée.
Que de sable lavé, que de rêves promis,
Pour qu'un peu d'or, enfin, reste au fond du tamis !
Prends ton bâton, chercheur ! La ville n'est pas proche,
Et d'obliques regards ont pesé ta sacoche.
D'autres, durs au travail sèment en rond les plombs
Des grands filets ; l'argent frétillant des poissons
Gonfle la trame grise, apportant l'odeur fraîche
Et fade qui s'attache aux engins de la pêche.
Mais le gain est précaire, et plus d'un écumeur
Descend, cadavre enflé, dans le flot endormeur.
Le fleuve emporte tout, d'ailleurs. Car de sa hache
Le bûcheron, tondeur des montagnes, arrache
Les sapins des hauteurs, qu'il confie au courant ;
Et, plus bas, la scierie industrieuse prend
Ces arbres, et, le Fleuve étant complice encore,
Les dépèce, malgré leur révolte sonore.
Puis la plaine avec ses moissons, puis les hameaux
D'où viennent s'abreuver, au bord, les animaux :
Bœufs, chevaux ; tandis qu'en amont, les lavandières
Font claquer leurs battoirs sur le linge et les pierres.
Ou bien plongent leurs bras nacrés dans l'eau qui court,
Et, montrant leurs pieds nus, le jupon troussé court,
Chantent une chanson où le roi les épouse.
Chanson, pieds nus, bras blancs, font que ce gars en blouse
Distrait, laisse aller seul son cheval fatigué,
Fumant, poitrail dans l'eau, par les courbes du gué.
Ces feuillages, en plein courant, couvrent quelqu'île
Qu'on voudrait posséder, pour y rêver tranquille.
Puis des collines à carreaux irréguliers,
Des petits bois ; plus près de l'eau, les peupliers
Et les saules. Le Fleuve élargi, moins rapide,
S'emplit de nénuphars, de joncs. Dans l'or fluide
Du soir, les moucherons valsent.
Mais, rapprochés,
Maintenant les coteaux s'élèvent. Des rochers
Interrompent souvent les cultures en pente.
Tout le pays pierreux, où le Fleuve serpente
Nourrit, pauvre et moussu, la ronce et le bandit.
Le courant étranglé dans les ravins, bondit
Sur les roches, ou bien dort dans les trous qu'il creuse.
Mais l'eau n'interrompt pas sa course aventureuse
Malgré tant de travaux et de sommeils. Voici
La brèche ouverte sur l'horizon obscurci
Par la poussière d'eau. Le lit de pierre plate
Finit brusque, et le flot, pesante nappe, éclate
En un rugissement perpétuel. En bas,
Les rocs éparpillés comme après des combats
De titans, brisent l'eau sur leurs arêtes dures.
Au loin, tout est mouillé. L'audace des verdures
Plantureuses encadre et rompt souvent l'éclat
De la chute écumeuse.
Ici le pays plat
Étale encor ses prés, ses moissons. Des rivières,
Venant on ne sait d'où, capricieuses, fières
Courent les champs, croyant qu'elles vivront toujours
Dans la parure en fleur de leur jeune parcours.
Mais le Fleuve vainqueur les arrête au passage,
Et fait taire ce rire en son cours vaste et sage.
Aux rives les hameaux se succèdent pareils.
Puis, voici l'industrie aux discordants réveils.
Les rossignols, troublés par le bruit et la suie
Des usines, s'en vont vers les bois frais qu'essuie
La pluie et qu'au matin parfume le muguet.
Le soleil luit toujours ; mais l'homme fait le guet.
Voilà qu'il a bâti des quais et des écluses ;
Et les saules cendrés, méfiants de ces ruses,
Et les peupliers fiers ne vont pas jusque-là.
Ces coteaux profanés, d'où le loup s'en alla,
S'incrustent de maisons blanches et de fabriques
Qui dressent gravement leurs hauts tuyaux de briques.
Sur le Fleuve tranquille, égayant le tableau,
Les jeunes hommes, forts et beaux, qui domptent l'eau,
Oublieux, en ramant, de l'intrigue servile,
S'en vont, joyeux, avec des femmes.
C'est la ville,
La ville immense avec ses cris hospitaliers,
L'eau coule entre les quais corrects. Des escaliers
Mènent aux profondeurs glauques du suicide.
À la paroi moussue un gros anneau s'oxyde,
Pour celui qui se noie inaccessible espoir.
Ligne capricieuse et noire sur le soir
Verdâtre, les maisons, les palais en étages
Se constellent. Au port, les ventes, les courtages
Sont finis. Le jour baisse, et les chauves-souris
Voltigent lourdement, poussant des petits cris.
Ces vieux quais oubliés sur leurs pierres disjointes
Supportent des maisons grises aux toits en pointes.
Là, sèchent des chiffons que de leurs maigres bras
Les femmes pauvres ont rincés. En bas, des rats.
Le flot profond, serré par les piles massives
Du pont, court plus féroce, et les pierres passives
Se laissent émietter par l'eau, tranquillement.
On voit s'allumer moins d'astres au firmament
Que de lumières sur les quais et dans les rues
Pleines du bruit des voix, des bals gais, parcourues
Par les voitures.
Seul, le Fleuve ne rit pas
Sous les chalands ventrus et lourds. D'ailleurs, en bas,
L'égout vomit l'eau noire aux affreuses écumes,
Roulant des vieux souliers, des débris de légumes,
Des chiens, des chats pourris qu'emmène le courant,
Souillure sans effet dans le Fleuve si grand
Dont la lune, œil d'argent, paillette la surface.
Mais, qu'importe la vie humaine à l'eau qui passe,
Les ordures, la foule immense et les bals gais ?
L'eau ne s'attarde pas à ces choses.
Les gués
Sont rompus, maintenant, en aval de la ville.
L'homme a dragué le lit du Fleuve, plus docile
Depuis qu'il est si large et si profond.
La mer
Aux bateaux goudronnés laisse un parfum amer
Qui parle des pays lointains où le vent mène.
Le Fleuve, insoucieux de l'industrie humaine,
Continue à travers la campagne. La nuit
S'avance triomphante et constellée, au bruit
Des feuilles que l'air frais emperle de rosée.
Puis, au matin, encore une ville posée
Dans la plaine, bijou de perle sur velours
Vert, dont tous ces coteaux imitent les plis lourds ;
Des fermes aux grands toits, bas et moussus, tapies
Au bord des prés sans fin où voltigent les pies,
Richesses qu'à mi-voix ce paysan pensif
Évalue en fouettant son vieux mulet poussif.
Le Fleuve s'élargit toujours, tant, que les rives
Perdent vers l'horizon leurs lignes fugitives.
Les coteaux abaissés, le ciel agité, l'air
Murmurant et salé, proclament que la mer
Est là, terme implacable à la folle équipée
De l'eau, qui vers le ciel chaud s'était échappée.
La mer demande tout fantasque, et puis, parfois
Refuse les tributs du Fleuve, limon, bois,
Cadavres, rocs brisés, qu'aux montagnes lointaines,
Aux terres grasses, aux hameaux, aux vastes plaines,
Il a volé, voulant rassasier la mer.
Et tout s'entasse, obstacle au Fleuve. L'homme fier
Trouve ici les débris distincts de chaque année,
Aux temps obscurs où sa race n'était pas née.
Tout le pays est gai. De loin le chant des coqs
Fend la brume. Voici les bassins et les docks,
Les cris des cabestans, les barques amarrées
D'où mille portefaix enlèvent les denrées,
Ballots, tonneaux, métaux en barres, tas de blés.
Aux cabarets fumeux, les marins attablés
Se menacent, avec des jurons exotiques.
On trouve tous les fruits lointains dans les boutiques.
L'eau du Fleuve s'arrête, un peu troublée, avant
De se perdre, innommée, en l'infini mouvant.
C'est comme une bataille en ligne régulière :
Escadrons au galop, soulevant la poussière,
Les vagues de la mer arrivent à grands bruits,
Blanches d'écume, ayant des airs vainqueurs, et puis
S'en retournent, efforts que le Fleuve repousse
Avec ses petits flots audacieux d'eau douce.
La mer fuit, mais emporte et disperse à jamais,
Rang par rang, tous ces flots, fils des lointains sommets.
Muse hautaine. Muse aux yeux clairs, sois bénie !
Malgré tes longs dédains, ma chanson est finie ;
Car tu m'as consolé de tous les bruits railleurs ;
Tu m'as montré, parmi mes souvenirs meilleurs,
Des lueurs pour teinter l'eau qui court et gazouille,
L'eau fraîche où, vers le soir, l'hirondelle se mouille.
Et j'ai suivi ses flots jusqu'à la grande mer.
Qu'on se lise entre amis ce chant tranquille et fier,
Dans les moments de fièvre et dans les jours d'épreuve,
Qu'on endorme son cœur aux murmures du Fleuve.
Charles Cros
_ _ _ _ _
39. Le miroir
Ville aveuglée à moins que ne la montre
À soi une rivière
Elle tire partage de l'eau
Et s'assied chez soi sur les berges
Un côté garde l'autre ils s'opposent et se voient
La rive se reflète en l'autre
Et chacune soi-même en le fleuve
Lui la dédouble et ainsi la redouble
Et permet qu'elle se connaisse
Michel Deguy («Poèmes de la Presqu’île», 1962 - Gallimard)
_ _ _ _ _
40. Mississipi
À cet endroit le fleuve est presque aussi large qu'un lac
Il roule des eaux jaunâtres et boueuses
entre deux berges marécageuses
Plantes aquatiques que continuent les acréages des cotonniers
Ça et là apparaissent les villes et les villages tapis au fond de quelque petite baie avec leurs usines
avec leurs hautes cheminées noires
avec leurs longues estacades qui s'avancent
eurs longues estacades sur pilotis
qui s'avancent bien avant dans l'eau
Chaleur accablante
La cloche du bord sonne pour le lunch
Les passagers arborent des complets à carreaux
des cravates hurlantes des gilets rutilants
comme les cocktails incendiaires et les sauces corrosives
On aperçoit beaucoup de crocodiles
Les jeunes alertes et frétillants
Les gros le dos recouvert d'une mousse verdâtre
se laissent aller à la dérive
La végétation luxuriante
annonce l'approche de la zone tropicale
Bambous géants palmiers tulipiers lauriers cèdres
Le fleuve lui-même a doublé de largeur
Il est tout parsemé d'îlots flottants d'où
l'approche du bateau fait s'élever
des nuées d'oiseaux aquatiques
Steam-boats voiliers chalands embarcations de toutes sortes et
d'immenses trains de bois
Une vapeur jaune monte des eaux surchauffées du fleuve
C'est par centaines maintenant
que les crocos s'ébattent autour de nous
On entend le claquement sec de leurs mâchoires
et l'on distingue très bien leur petit œil féroce
Les passagers s'amusent à leur tirer dessus
avec des carabines de précision
Quand un tireur émérite réussit ce tour de force
de tuer ou de blesser une bête à mort
Ses congénères se précipitent sur elle la déchirent
Férocement
Avec des petits cris assez semblables
au vagissement d'un nouveau-né
Blaise Cendrars («Fleuve», 1947, éditions Denoël)
_ _ _ _ _
41. Le murmure du fleuve
Oh ! les matins d’été près du fleuve, où l’on rêve
Dans l’herbe, ou comme nous, repose le soleil,
Quand l’onde passe, lente, et murmure sans trêve,
Emportant des reflets de feuilles et de ciel ...
Oh ! le miroir tremblant où se penchent les arbres,
Le désir de s’étendre en l’eau et d’y rester,
De s’assoupir afin de longuement songer.
Il semble qu’on serait alors tout à fait calme,
Qu’on ne penserait plus à rien et qu’on irait
— Ainsi que ces esquifs de bois ou de papier
Que jettent les petits enfants au bord du sable —
Qu’on irait on ne sait bien où ... très loin ... peut-être
Dans quelque ville heureuse où les gens seraient beaux,
Ou sous des arbres noirs, au creux des forêts vierges,
Écoutant murmurer à nos oreilles l’eau.
Car, c’est surtout le chant du fleuve qui nous trouble,
Le murmure éternel qui s’apaise et renaît,
Qui s’éloigne parfois avec le flot qui roule,
Mais qui ne cesse pas quand le flot disparaît ;
Le murmure qui vient, le murmure qui passe
Avec l’onde, et revient pour repartir encor,
Et doucement, ainsi qu’au doigt un anneau d’or,
Glisse sur notre esprit, le caresse et l’enlace ...
Marcel Marchandeau, alias Touny-Lerys («La Pâque des roses», 1909, Mercure de France)
_ _ _ _ _
42. Si j’étais gabarre ou chaland
Si j’étais gabarre ou chaland
Au bout d’une corde qui grince,
Beau fleuve lent,
Je descendrais vers tes provinces.
Si j’étais un noyé tranquille,
Je m’en irais entre deux eaux,
Cherchant quelque île
Où m’endormir dans les roseaux.
Peuplier de la Caroline,
Je répandrais d’un geste doux
Mon ombre fine
Sur les flots plats et sans remous.
Rayon de lune ou feuille morte,
Je voudrais, léger et dansant,
Que tu m’emportes
Voir d’autres pays en passant.
Mais que suis-je, sinon poète,
(Autant dire un cœur plein d’ennuis),
Ma cigarette
M’éclairant seule dans la nuit ?
Jean de la Ville de Mirmont (1886-1914)
Le poète a été tué au Chemin des Dames pendant la Première guerre mondiale. Il n’avait que 28 ans ...
("L'horizon chimérique" - "Société littéraire de France, 1920 et Raymond Picquot éditeur, actuellement disponible chez Grasset)
_ _ _ _ _
43. La Sorgue
Chanson pour Yvonne
Rivière trop tôt partie, d’une traite, sans compagnon,
Donne aux enfants de mon pays le visage de ta passion.
Rivière où l’éclair finit et où commence ma maison,
Qui roule aux marches d’oubli la rocaille de ma raison.
Rivière, en toi terre est frisson, soleil anxiété.
Que chaque pauvre dans sa nuit fasse son pain de ta moisson.
Rivière souvent punie, rivière à l’abandon.
Rivière des apprentis à la calleuse condition,
Il n’est vent qui ne fléchisse à la crête de tes sillons.
Rivière de l’âme vide, de la guenille et du soupçon,
Du vieux malheur qui se dévide, de l’ormeau, de la compassion.
Rivière des farfelus, des fiévreux, des équarrisseurs,
Du soleil lâchant sa charrue pour s’acoquiner au menteur.
Rivière des meilleurs que soi, rivière des brouillards éclos,
De la lampe qui désaltère l’angoisse autour de son chapeau.
Rivière des égards au songe, rivière qui rouille le fer,
Où les étoiles ont cette ombre qu’elles refusent à la mer.
Rivière des pouvoirs transmis et du cri embouquant les eaux,
De l’ouragan qui mord la vigne et annonce le vin nouveau.
Rivière au coeur jamais détruit dans ce monde fou de prison,
Garde-nous violent et ami des abeilles de l’horizon.
René Char ("Fureur et mystère", Éditions Gallimard, 1948)
_ _ _ _ _
44. La rivière endormie
Dans son sommeil glissant l’eau se suscite un songe
Un chuchotis de joncs de roseaux d’herbes lentes
Et ne sait jamais bien dans son dormant mélange
Où le bougeant de l’eau cède au calme des plantes
La rivière engourdie par l’odeur de la menthe
Dans les draps de son lit se retourne et se coule
Mêlant ses mortes eaux à sa chanson coulante
Elle est celle qu’elle est surprise d’être une autre
L’eau qui dort se réveille absente de son flot
Ecarte de ses bras les lianes qui la lient
Déjouant la verdure et l’incessant complot
Qu’ourdissent dans son flux les algues alanguies.
Claude Roy ("Poésies", Gallimard, 1970)
_ _ _ _ _
45. Eté : les truites
à P.L. Berthaud
Il grêle avec un bruit de perles,
Perles du soleil, perles des lacs,
Truites étrusques et de l’Iran,
Au dos d’or, au ventre de laque,
Reines des vergers transparents,
Elles glissent sous les reflets des peupliers qui tremblent.
Les ballerines du silence.
"— Quand je vais promener en barque,
La tête lourde d’avoir pleuré,
Je vous nourrirai, mes carpes,
Je vous nourrirai."
Les oiseaux oscillent, se penchent
Et jouent sur leurs triangles d’or.
Mais les truites en robe fauve
Traversent les arbres des morts.
Tout le paysage est tombé dans l’eau :
Les truites nagent entre les arbres.
Les oiseaux glissent sur les vagues
Et les écluses chantent, chantent
Sur ce monde renversé.
Il grêle avec un bruit de perles …
Mais l’aurore, d’un sourire,
Rouvrira ces vergers chantants.
Maurice Fombeure ("À dos d’oiseau", Gallimard, 1942)
_ _ _ _ _
46. Que tu es simple et claire ...
Que tu es simple et claire,
Eau vivante,
Qui, du sein de la terre,
Jaillis en ces bassins et chantes !
Ô fontaine divine et pure,
Les plantes aspirent
Ta liquide clarté ;
La biche et la colombe en toi se désaltèrent.
Et tu descends par des pentes douces
De fleurs et de mousses,
Vers l’océan originel,
Toi qui passes et vas, sans cesse, et jamais lasse
De la terre à la mer et de la mer au ciel.
Souvent, à l’heure où l’ombre te couvre,
Ô source, je me penche sur toi,
Et j’y laisse flotter mes cheveux et mes doigts,
Que tu entraînes et entr’ouvres,
Mais tu te caches, tu fuis en eux,
Et c’est moi-même que je trouve
En te cherchant, Nymphe aux yeux bleus.
Charles Van Lerberghe ("Chanson d'Ève", G Crès éditeur, 1904)
_ _ _ _ _
47. Le ruisseau
Beaucoup d’eau a passé sous les ponts
et puis aussi énormément de sang
Mais aux pieds de l’amour
coule un grand ruisseau blanc
Et dans les jardins de la lune
où tous les jours c’est ta fête
ce ruisseau chante en dormant
Et cette lune c’est ma tête
où tourne un grand soleil bleu
Et ce soleil c’est tes yeux.
Jacques Prévert ("Histoires" - Éditions Gallimard, 1946 et 1963)
_ _ _ _ _
48. La Loire au plus près (fragments)
La Loire est une aïeule
qui se souvient
de son éternité liquide
Elle est l'eau millénaire
où l'arbre couche son ombre
et tu bois ton rêve
à ses rives vertes
pour préserver l'imaginaire.
----------------------------------------
L'eau immobile
nous raconte des fonds imaginaires
où les racines feuillues
atteignent au centre de la terre. Miroir magique
qui enfante des arbres bicéphales
douce folie du printemps
née d'un ciel voilé
percé de mille boutons du jeune soleil.
----------------------------------------
Loire reflet
tu témoignes du ciel
dans la liberté
d'une onde froissée, brisée
par un vent nomade.
----------------------------------------
Le ciel de Loire
est descendu vers nous
mais quel limon
a volé sa lumière
au désarroi de l'eau ?
Claudia Adrover ("La Loire au plus près" - éditions Donner à Voir, 1999)
_ _ _ _ _
49. Printemps kurde (deuxième strophe)
[...]
Je me souviens
Le fleuve était en crue
Le ciel gorgé de pluie s'étirait comme une bête
sur d'interminables friches noires
L'outarde, la cigogne
et tout ce que j'ai aimé ensuite
y nichaient déjà en secret
[...]
Mahabad - Genève, 1981
Nicolas Bouvier ("Le Dehors et le dedans", Éditions Zoé, 1978 et 1998 - et en Points/Gallimard, 2007)
_ _ _ _ _
50. Les rivières claires
(titre proposé, extrait du poème "Le Satyre")
[...]
Ce chemin me conduira aux rivières claires où l'on
se baigne entre deux rives de gazon.
Rivières ombragées par les arbres,
Effleurées par l'aile des oiseaux,
Eau pure, eau pure, vous me lavez.
Je m'abandonnerai à ton courant dans lequel naviguent
les feuilles encore vertes que le vent fit tomber.
Eau pure qui lave sans arrêt les images reflétées.
Eau pure qui frissonne sous le vent,
Je me baignerai et je laisserai le reflet de moi-même
en toi-même, eau pure !
Tu le laveras, ce reflet où je ne veux me reconnaître,
Ou bien emporte-le, loin,
Jusqu'aux océans qui le dissoudront comme du sel.
[...]
Robert Desnos ("Le Satyre" dans "Fortunes" - éditions Gallimard, 1969 - publication posthume)
_ _ _ _ _
51 et 52. Deux textes sur la même rivière :
La rivière Bièvre est un affluent de la Seine. La vallée de la Bièvre, que Victor Hugo, Ronsard, et plus récemment jean Moréas ont mise en vers, est aujourd'hui pour les naturalistes et les amateurs de paysages, de flore et de faune, un lieu de balades (et de ballades, pour les poètes).
De Massy-Palaiseau à Antony, en passant par Verrières-le Buisson et Jouy-en-Josas, son parcours est semé de lavoirs et de moulins plus ou moins restaurés.
51. Bièvre (passages)
À Mademoiselle Louise B.
I
[...]
Une rivière au fond ; des bois sur les deux pentes.
Là, des ormeaux, brodés de cent vignes grimpantes ;
Des prés, où le faucheur brunit son bras nerveux ;
Là, des saules pensifs qui pleurent sur la rive,
Et, comme une baigneuse indolente et naïve,
Laissent tremper dans l'eau le bout de leurs cheveux.
Là-bas, un gué bruyant dans des eaux poissonneuses
Qui montrent aux passants lés jambes des faneuses ;
Des carrés de blé d'or ; des étangs au flot clair ;
Dans l'ombre, un mur de craie et des toits noirs de suie ;
Les ocres des ravins, déchirés par la pluie ;
Et l'aqueduc au loin qui semble un pont de l'air.
Et, pour couronnement à ces collines vertes,
Les profondeurs du ciel toutes grandes ouvertes,
Le ciel, bleu pavillon par Dieu même construit,
Qui, le jour, emplissant de plis d'azur l'espace,
Semble un dais suspendu sur le soleil qui passe,
Et dont on ne peut voir les clous d'or que la nuit !
Oui, c'est un de ces lieux où notre coeur sent vivre
Quelque chose des cieux qui flotte et qui l'enivre ;
Un de ces lieux qu'enfant j'aimais et je rêvais,
Dont la beauté sereine, inépuisable, intime,
Verse à l'âme un oubli sérieux et sublime
De tout ce que la terre et l'homme ont de mauvais !
II
Si dès l'aube on suit les lisières
Du bois, abri des jeunes faons,
Par l'âpre chemin dont les pierres
Offensent les mains des enfants,
A l'heure où le soleil s'élève,
Où l'arbre sent monter la sève,
La vallée est comme un beau rêve.
La brume écarte son rideau.
Partout la nature s'éveille ;
La fleur s'ouvre, rose et vermeille ;
La brise y suspend une abeille,
La rosée une goutte d'eau !
Et dans ce charmant paysage
Où l'esprit flotte, où l'oeil s'enfuit,
Le buisson, l'oiseau de passage,
L'herbe qui tremble et qui reluit,
Le vieil arbre que l'âge ploie,
Le donjon qu'un moulin coudoie,
Le ruisseau de moire et de soie,
Le champ où dorment les aïeux,
Ce qu'on voit pleurer ou sourire,
Ce qui chante et ce qui soupire,
Ce qui parle et ce qui respire,
Tout fait un bruit harmonieux !
[...]
IV
Et l'on ne songe plus, tant notre âme saisie
Se perd dans la nature et dans la poésie,
Que tout près, par les bois et les ravins caché,
Derrière le ruban de ces collines bleues,
A quatre de ces pas que nous nommons des lieues,
Le géant Paris est couché !
On ne s'informe plus si la ville fatale,
Du monde en fusion ardente capitale,
Ouvre et ferme à tel jour ses cratères fumants ;
Et de quel air les rois, à l'instant où nous sommes,
Regardent bouillonner dans ce Vésuve d'hommes
La lave des événements !
8 juillet 1831
Victor Hugo ("Les Feuilles d'automne" - 1831)
_ _ _ _ _
La même rivière dans sa vallée, mise en vers par Jean Moréas :
52. Memento *
La route monte entre des murs et tourne et longe l'enclos planté d'arbres rangés, qui n'ont encore de vert, sinon un peu de mousse.
Allée, platanes
De belle écorce,
Vieux bancs de pierre,
Je vous revois
Dans la lumière
De cette fin
D'hiver bénin.
Dans la vallée
Au creux charmant
La Bièvre coule
Et se déroule
Comme un ruban.
Jean Moréas ("Esquisses et souvenirs", Mercure de France, 1908) * Memento signifie ici Souviens-toi.
On pourrait titrer ce texte «La Bièvre».
_ _ _ _ _
53. Les bords de la Marne
La Marne, lente et molle, en glissant accompagne
Un paysage ouvert, éventé, spacieux.
On voit dans l'herbe éclore, ainsi qu'un astre aux cieux,
Les villages légers et dormants de Champagne.
La Nature a repris son rêve négligent.
Attaché à la herse un blanc cheval travaille.
Les vignobles jaspés ont des teintes d'écaille
À travers quoi l'on voit rôder de vieilles gens.
Un automnal buisson porte encor quelques roses.
Une chèvre s'enlace au roncier qu'elle mord.
Les raisins sont cueillis, le coteau se repose,
Rien ne témoigne plus d'un surhumain effort
Qu'un tertre soulevé par la forme d'un corps.
Anna de Noailles ("Les Forces éternelles", 1920)
_ _ _ _ _
Un poème proposé en 2011 pour le 13ème Printemps des poètes sur le thème "d'infinis paysages" dans la "poéthèque" du site du Printemps des Poètes à cette adresse : http://www.printempsdespoetes.com
54. Tu cours superbe, ô Rhosne, flourissant *
Tu cours superbe, ô Rhosne, flourissant
Les bords imaginaires du voyage
les rives vertes où l'on s'use en passant
aux tourbillons, aux rhombes des nuages.
Ton couteau nu entraîne nos images
de vie si promptes à rejoindre les puits
où demain les noiera d'une eau d'oubli
et là s'apaiseront les jours amers
quand jusqu'à l'os léchés nos mots blanchis
seront le temps qui pose sur la mer.
Annie Salager
* l’auteure a repris le premier vers du poème de Maurice Scève dans son écriture originale en ancien français.
Annie Salager ("Printemps des Poètes 2005" - "Hommage à Maurice Scève, sa Délie aux quatre cent quarante neuf dizains décasyllabiques, rimés en ABAB BC CDCD")
_ _ _ _ _
ci-dessous un passage du poème de Maurice Scève en question, ici en français moderne
55. Tu cours superbe, ô Rhône, florissant
Tu cours superbe, ô Rhône, florissant
En sablon d'or et argentines eaux.
Maint fleuve gros te rend plus ravissant,
Ceint de cités, et bordé de châteaux,
Te pratiquant par sûrs et grands bateaux
Pour seul te rendre en notre Europe illustre.
Mais la vertu de ma Dame t'illustre
Plus qu'autre bien qui te fasse estimer.
Enfle-toi donc au parfait de son lustre,
Car fleuve heureux plus que toi n'entre en mer.
Maurice Scève, 1500-1560 ("Délie")
_ _ _ _ _
56. L'ombre des arbres dans la rivière embrumée
L'ombre des arbres dans la rivière embrumée
Meurt comme de la fumée
Tandis qu'en l'air, parmi les ramures réelles,
Se plaignent les tourterelles.
Combien, ô voyageur, ce paysage blême
Te mira blême toi-même,
Et que tristes pleuraient dans les hautes feuillées
Tes espérances noyées !
Paul Verlaine ("Romances sans paroles", 1874)
_ _ _ _ _
-
57.Au fleuve
Je prendrai de ton eau dans le creux de mes mains,
Fleuve, pour te humer et pour mouiller mes tempes !
Que ne suis-je l'enfant qu'on voit dans les estampes
Graver son humble nom sur tes arceaux romains !
Maintes gloires par qui l'âme s'exalte, maints
Héros et maints penseurs, quels rêves sous les lampes.
Brûlent de cet éclat sacré dont tu les trempes,
Ces héros, ces penseurs, ces hommes surhumains,
Ces dieux ! La nuit stellaire enveloppe leur trône,
Voici l'aurore éclose aux flots, voici le Rhône
Impétueux, au pied des rocs et des cités
Qu'effleure de frissons le soleil comme une aile
S'allonger en détours d'ombres et de clartés
Vers le rayonnement de la mer éternelle.
André Fontainas (1865-1948)
-
58.Les ziaux
les eaux bruns, les eaux noirs, les eaux de merveille
les eaux de mer, d'océan, les eaux d'étincelles
nuitent le jour, jurent la nuit
chants de dimanche à samedi
les yeux vertes, les yeux bleues, les yeux de succelle
les yeux de passante au cours de la vie
les yeux noirs, yeux d'estanchelle
silencent les mots, ouatent le bruit
eau de ces yeux penché sur tout miroir
gouttes secrets au bord des veilles
tout miroir, tout veille en ces ziaux bleues ou vertes
les ziaux bruns, les ziaux noirs, les ziaux de merveille
Raymond Queneau ("Les Ziaux",Métamorphoses, Gallimard, 1943)
TEXTE EN PROSE
Passages du recueil "Les eaux étroites", où l'auteur met en prose poétique ses souvenirs des promenades qu'il faisait enfant sur les bords de l'Èvre, rivière du Maine-et-Loire qui zigzague dans "un canton retranché de la terre" :
59. L'Èvre (titre proposé)
La végétation épaisse de ses rives, l’étroitesse de son cours, la noirceur de son eau mangeuse d’ombres et ses coteaux surplombants donnent à cette rivière un caractère mystérieux, celui d’un canton retranché de la terre dont la barque seule pouvait livrer la clef ...
La petite rivière semblait de bout en bout zigzaguer à travers un parc naturel ensauvagé, un recels protégé du loisir et du dimanche, où nulle part ne se montraient les stigmates du travail… l'Èvre n'a guère qu'une vingtaine de mètres de large, parfois moins ; le lit est profond, criblé entre les souches pourries de trous et d'anfractuosités où s'abritent les brochets géants. Sans doute la pollution a-t-elle dépeuplé aujourd'hui la rivière comme toutes les autres, mais dans mon enfance une partie de pèche sur l'Èvre signifiait qu'on courrait * sus au gros gibier : ces eaux couleur de réglisse passaient pour nourrir des bêtes centenaires"…
Les branches des arbres haut perchés sous lesquels on glisse, les branches du pin ami des rochers qui se penchent anguleuses au-dessus de l’eau dans les lavis chinois, accentuent le sentiment d’ivresse calme, et peuvent d’un moment à l’autre faire succéder au caprice d’un ruban d’eau cerné de précipices l’intimité protégée, la fuite attirante des voûtes d’arbres qui couvrent en berceau un canal courant droit jusqu’à l’horizon. On s’abandonne les yeux fermés à l’eau qui, inépuisablement, ouvre les chemins ...
... Ainsi, pendant de longues minutes, la barque progresse dans le silence glauque ; en même temps que le soleil, les falaises arrêtent jusqu’au moindre souffle d’air. Au milieu de l’excursion de l'Èvre, ces moments de silence, dans ma mémoire, viennent se poser, comme un long point d’orgue ; ce silence, un doigt sur les lèvres, debout et immobile, et matérialisé à demi au creux de ces étroits pleins de présences païennes, c’est vraiment le "génie du lieu" qui l’impose ...
La barque s'est amarrée de nouveau à la rive ; l'enclenchement familier du cadenas est comme le fermoir de la journée close, une journée en dehors des jours. Le présent et l'imparfait, inextricablement, se mêlent dans le défilé d'images de cette excursion que j'ai faite vingt fois, que rien ne m'interdirait encore aujourd'hui de refaire ...
L'interdit qui m'arrête au moment de m'embarquer de nouveau sur l'étroite rivière immobile ne procède pas de la crainte de désenchanter un souvenir. Bien plutôt à l'impuissance où l'on est, sinon de ranimer un rêve, du moins de retrouver dans l'état de veille à la fois sa lumière sans noyau et son rythme, qui ne cesse de changer, sans pour autant entretenir le moindre rapport avec la vitesse et la lenteur ...
Mais tout ce qui a la couleur du songe est, de nature, prophétique et tourné vers l'avenir, et les charmes qui autrefois m'ouvraient les routes n'auraient plus ni vertu, ni vigueur : aucune de ces images aujourd'hui ne m'assigneraient plus nulle part, et tous les rendez-vous que pourrait me donner encore l'Èvre, il n'est plus de temps maintenant pour moi pour les tenir ...
Julien Gracq ("Les eaux étroites", Éditions José Corti, 1976) - * deux "r" pour le futur : "qu'on allait courir"
TEXTE EN MARGE
Et pour terminer ce poème qui ne s’encombre pas des règles du langage de la poésie classique, par le chansonnier du début du siècle dernier, Mac-Nab (1856-1889), auteur de la chanson «Le Grand Métingue du Métropolitain», popularisant les grèves de Vierzon, sa ville.
On y découvre une Seine peu ragoûtante ...
60. Une pleine eau
La s’maine, et surtout l’dimanche,
Ça devrait pas êt’ permis
De nager et d’fair’ la planche
Dans l’eau qui coule à Paris.
À Paris, la Seine est trouble
Et ça n’est pas drôl’ du tout
D’barboter dans du gras double ;
J’m’en vas m’baigner à Chatou.
À Chatou, près d’la rivière,
Je me transporte aussitôt,
Mais j’me dis : « L’eau n’est pas claire,
Allons nous baigner plus haut. »
Je marche et j’arrive en face
Du dépotoir de Saint-Ouen,
Alors je fais un’ grimace,
La Seine est jaun’ comme un coing.
Je r’mont’ le cours de la Seine
Toujours sur le bord de l’eau
En m’disant tout bas : « Pas d’veine,
Allons nous baigner plus haut ! »
Plus haut, près du pont d’Asnières,
J’m’apprête à faire un plongeon,
Mais le fleuv’, chos’ singulière,
Est plus noir que du charbon !
Je r’mont’ le cours de la Seine
Toujours sur le bord de l’eau,
En m’disant tout bas : « Pas d’veine,
Allons nous baigner plus haut ! »
Au détour de Courbevoie,
Je m’écrie : « C’est là, parbleu !
Que j’me baign’rais avec joie ;
Mais le liquide est tout bleu ! »
Je r’mont’ le cours de la Seine
Toujours sur le bord de l’eau,
En m’disant tout bas : « Pas d’veine,
Allons nous baigner plus haut ! »
Bientôt j’arrive à Suresnes
Près d’un site ravissant,
Mais soudain je vois la Seine
Qui devient couleur de sang !
Je r’mont’ le cours de la Seine
Toujours sur le bord de l’eau,
En m’disant tout bas : « Pas d’veine,
Allons nous baigner plus haut ! »
Plein d’une ardeur opiniâtre,
Je pousse jusqu’à Meudon ;
Mais là, le fleuve est blanchâtre
Et roul’ des flots d’amidon !
Je r’mont’ le cours de la Seine
Toujours sur le bord de l’eau,
En m’disant tout bas : « Pas d’veine,
Allons nous baigner plus haut ! »
Enfin, trouvant l’eau moins grasse,
Je m’décide à Billancourt ;
J’pique un’ tête dans la carcasse
D’un chien crevé d’puis quinz’ jours !
Depuis c’jour-là je m’méfie
Et chaq’ soir de huit à neuf
Je m’en vais sans cérémonie
Tirer ma coup’ sous l’Pont-Neuf !
Maurice Mac-Nab («Poèmes incongrus»)
... Et la Seine, comme une couleuvre coulée,
Parmi ton herbe Normandie, la Seine d'or,
La Seine bleue qui se glisse et remonte, osée,
Toute annelée, vers sa source, où elle s'endort.
Guy Lavaud
Je prendrai de ton eau dans le creux de mes mains,
Feuve, pour te humer et pour mouiller mes tempes !
André Fontainas
L'aurore grelottante en robe rose et verte
S'avançait lentement sur la Seine déserte,
Et le sombre Paris, en se frottant les yeux,
Empoignait ses outils, vieillard laborieux.
Charles Baudelaire
L’eau courante chantante
mille déjeuners de soleil
mille fêtes d’innocence
l’insouciance faite ciel ...
Claude Roy
textes COLLÈGE - LYCÉE
L’oreille abandonnée aux mots nus du flot doux.
Paul Valéry
Dans son sommeil glissant l’eau se suscite un songe
un chuchotis de joncs, de roseaux, d’herbes lentes ...
Claude Roy
haïku
La Seine va son train, flegmatique,
sûre d’atteindre
un jour le gris pâle de la mer.
Jacques Pestri
Paris n'a de beauté qu'en son histoire,
Mais cette histoire est belle tellement !
La Seine est encaissée absurdement,
Mais son vert clair à lui seul vaut la gloire.
Verlaine
